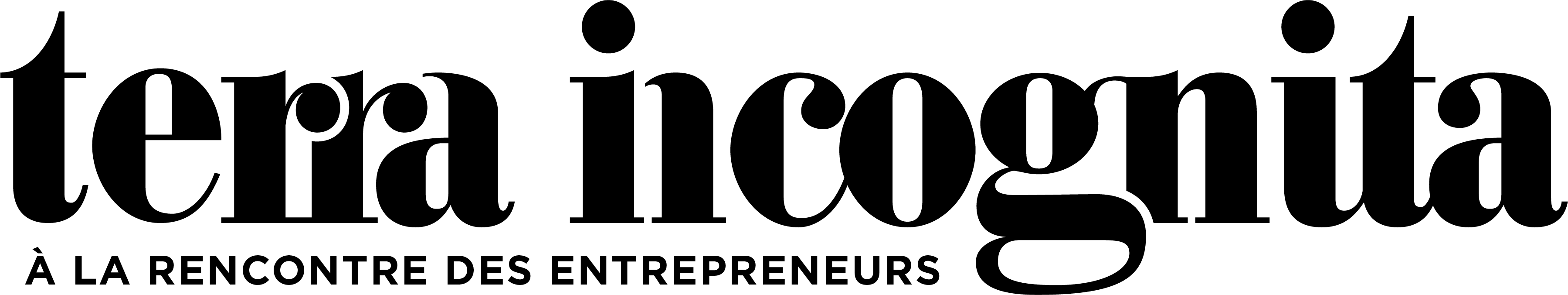ENVIRONNEMENT
« Buy less, choose well, make it last » : vers une mode éthique?
par Sonia Pavlik
« Victime de la mode, tel est son nom de code », chantait MC Solaar en 1991 dans son tube sur les diktats de la minceur. Presque 30 ans plus tard, après les assauts des féministes, des défenseurs des animaux et du droit du travail, le monde de la mode doit rendre des comptes à la planète. Le secteur du textile est l’un des plus polluants au monde et, s’il maintient sa cadence, son impact sur le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles sera encore plus inquiétant en 2050. Face à l’urgence écologique, difficile d’attendre la prise de mesures les bras croisés. Bonne nouvelle, il existe déjà des solutions et de bons gestes à (re)prendre. Mais par où commencer, chacun à notre échelle ?
TERRA INCOGNITA #6 ● CLIMAT, IL EST TROP TARD POUR NE RIEN FAIRE
Rappel sur le système actuel
Derrière l’image frivole et virevoltante des tendances, les enjeux du vêtement sont lourds. En 2013, l’effondrement du Rana Plaza, qui a causé la mort de plus de 1120 ouvriers à Dacca, au Bangladesh, a révélé les conditions de travail précaires chez les sous-traitants de grands groupes textiles. À cette première onde de choc se sont ajoutés des rapports préoccupants quant aux conséquences de la production textile sur l’environnement. L’industrie textile compte parmi les plus gros pollueurs. Quelle que soit sa place dans ce triste palmarès, les données qui la concernent demeurent édifiantes. En 2017, on estimait son impact annuel à un milliard de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui est, selon l’Ademe, supérieur à celui des transports aérien et maritime réunis.
Malheureusement, les dommages ne s’arrêtent pas là.
L’industrie textile est aussi l’une des plus gourmandes en eau, dont 93 milliards de mètres cubes lui seraient nécessaires chaque année. Autre élément à sa charge, et non des moindres, elle a été identifiée par la Fondation Ellen Mac Arthur comme l’une des principales coupables de la pollution plastique des océans, avec environ un demi-million de tonnes de microfibres versées chaque année lors du lavage de textiles. Un grief supplémentaire concerne les matières premières. Les champs de coton ingurgitent un quart des pesticides épandus à travers le globe alors qu’ils ne couvrent que 2,5% des surfaces cultivées. Ajoutons que selon l’OMS, 22 000 personnes décèdent chaque année parce qu’elles y sont exposées.
Respirez, si l’on peut dire, ce n’est pas fini.
Pendant la confection, des kilomètres de tissus sont gâchés tandis que les teintures et l’ennoblissement requièrent l’utilisation de produits chimiques très toxiques qu’on retrouve ensuite dans la nature. Dès 2012, Greenpeace a rapporté l’utilisation d’environ 1,7 million de tonnes de produits nocifs et de colorants tous les ans… Et que dire du transport ? Outre l’empreinte carbone des véhicules, des gaz de conservation toxiques diffusés dans des conteneurs contaminent les marchandises…
Dans le désastreux tableau du système actuel, chaque étape du cycle de vie du vêtement est impliquée. La mode pollue à grande échelle, de Paris au Bangladesh, des champs de coton jusqu’aux tissus que nous portons. Comment l’expliquer ?
Dans les années 1980 et 1990, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la fast fashion, qui propose toujours plus de vêtements fabriqués à moindre coût et vendus à bas prix, le tout à un rythme frénétique. Plus les prix sont faibles, plus les marges sont basses, plus il faut vendre de gros volumes pour compenser. Rien qu’en France, chaque année, 700 000 tonnes de textiles – vêtements et linge de maison – et de chaussures entrent sur le marché. Dans les rayons, le réassort permanent triomphe. Fini les traditionnelles Printemps-Été et Automne-Hiver. Entre les capsules et les pré-collections, certaines marques de prêt-à-porter mettent désormais en avant un nouveau vestiaire tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Figure de proue de ce phénomène, une enseigne comme Zara voit défiler plus de 12 000 modèles chaque année dans ses boutiques. Toute cette surproduction génère, comme pour l’alimentation, un gaspillage colossal. En 2000, on estimait que 50 milliards de nouvelles pièces étaient sorties des ateliers, en 2018, on en a compté 140 milliards, soit presque le triple. Que deviennent ces volumes si conséquents ? Ils finissent en grande partie en invendus, avant de se transformer en déchets – quand ils ne sont pas brûlés.
Et pour produire plus vite, il a fallu aller plus loin.
Dans sa course folle, la fast fashion s’est appuyée sur la délocalisation de leur production, sous-traitée en Europe de l’Est ou en Asie, où les salaires sont bien moindres et les réglementations loin des normes européennes. Les importations des produits d’habillement et de cuir représentaient 2 % des vêtements vendus en France en 1960, alors qu’on les évaluait à plus de 70 % en 2013. Outre l’augmentation de l’empreinte carbone des transports, l’éloignement a longtemps contribué à la posture psychologique du déni ou de l’ignorance consentie. Loin des yeux, loin du cœur.
Face à ces données alarmantes, des initiatives ont été mises en place. Si en août 2019, au G7, des géants de luxe et du prêt-à-porter ont promis, sans trop de contraintes cependant, de bannir l’utilisation de plastique à usage unique pour préserver l’environnement marin et d’atteindre l’objectif du zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050, le gouvernement a lancé en juin le projet de loi d’interdire de brûler ou de jeter les invendus, adopté fin septembre par le Sénat.
Chez les acteurs du secteur, les actions se multiplient pour changer la donne.
L’écoconception apparaît comme un idéal à atteindre pour une mode qui se rêve désormais « durable ». Des collectifs de professionnels s’organisent. Parmi eux, l’association Fashion Revolution, qui réunit les créateurs engagés et les consommateurs pour inciter les grandes marques à agir pour la planète, ou Une autre mode est possible qui, sur le modèle d’un label de musique indépendant, mutualise les réseaux, les expertises et les savoir-faire pour le développement de ses membres. En 2021, un espace innovant, La Caserne, ouvrira ses portes à Paris pour sensibiliser le public à ces questions et aider les marques existantes à accélérer leur transition écologique, notamment grâce à des formations ou à un sourcing de matériaux qui garantira leur traçabilité. Comme le rappelle Maeva Bessis, directrice générale adjointe du site L’Exception, qui pilote le projet, « si les solutions existent, un des problèmes pour les créateurs reste le rythme de l’industrie et la vitesse avec laquelle ils doivent fournir de nouvelles collections. Si la volonté d’utiliser des tissus et des matériaux écologiques et responsables est bien là, ils n’en disposent pas forcément à portée de main. » D’où l’intérêt de lieux où ils peuvent les trouver facilement. Les Galeries Lafayette ont lancé de leur côté le mouvement Go For Good qui plaide pour un changement de donne à travers une sélection de marques et de produits respectueux de l’environnement et du développement social. Comme les magasins d’alimentation bio, la mode écoresponsable semble promise à un bel avenir. D’ailleurs, si l’on peut s’interroger sur l’aspect greenwashing et l’engagement réel de certaines enseignes, comme H&M avec sa collection Conscious, la présence même de cette gamme montre que la demande et le besoin sont bel et bien là, ce qui est un début.
Une question se pose néanmoins. Paraît-il vraisemblable que la surabondance de l’offre s’arrête d’elle-même ? Probablement pas. Sans vouloir culpabiliser les consommateurs, ces derniers ont un rôle essentiel dans le développement de la fast fashion. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), « une personne achète en moyenne 60 % de vêtements en plus qu’il y a 15 ans, et les conserve moitié moins longtemps. » Serions-nous tous atteints d’oniomanie, c’est-à-dire de fièvre acheteuse ? Comment avons-nous commencé à consommer les t-shirts comme des kleenex ? Sollicités par les multiples rabais, en magasin ou sur le net, nous avons pris l’habitude d’acquérir en permanence, toute l’année, des produits à bas prix. En 2015, 45% des vêtements ont été dénichés en soldes… Résultat, nos armoires débordent, le plus souvent en vain. 2/3 des Français déclarent avoir acheté des vêtements qu’ils ne portent jamais… Et chaque année, nous jetons 12 kg de vêtements !
Mais fait-on vraiment une bonne affaire si notre t-shirt à 4 euros se retrouve hors d’usage en une saison à peine ou si notre pantalon à 19 euros est mal coupé ? La prospérité de la fast fashion repose bien souvent sur des comportements addictifs, sur la satisfaction immédiate d’une compulsion momentanée. Concevoir l’achat d’un vêtement comme un investissement à long terme, si on a les moyens de le faire, ne serait-il pas le début d’une libération, voire d’une désintoxication ?
Si les victimes de la mode s’épuisent à courir vers l’idéal promis par la toute nouvelle pièce dernier cri, chaque vêtement véhicule avec lui un imaginaire et exprime la personnalité de celui qui l’affiche, qu’il veuille passer inaperçu ou au contraire, se faire remarquer. Il révèle l’identité, l’appartenance, parfois l’intimité du rapport qu’un individu entretient avec le monde. Si l’on est ce qu’on mange, pourquoi ne serait-on pas ce que l’on porte ? La solution ne serait-elle pas de poser un nouveau regard sur nos habits, qu’on s’attarde sur leur style ou qu’on ne les considère que comme des biens utiles et fonctionnels ? Comme le souligne Maeva Bessis, « on doit déconstruire la relation que l’on a aux vêtements pour réapprendre à en tomber amoureux. Aujourd’hui, en être fier, ce n’est plus seulement aimer leur style. C’est aussi apprécier leurs matières, leur composition et la transparence de leur fabrication. Et comme dans toute relation, on doit se poser certaines questions : sur quels critères les choisir ? Comment faire pour les garder le plus longtemps possible ? Comment en prendre soin ? Selon le principe du crowd power, on peut redonner du pouvoir à son acte d’achat et en faire un vote pour le monde qu’on veut voir demain. »
Mais si on fait de son vêtement un partenaire de vie, comment le choisir ? Il ne s’agit pas forcément de remplacer tout son dressing d’un coup, mais plutôt de procéder par étapes, en se posant des questions primordiales lors de son prochain achat : à qui j’achète ? Comment et où est-ce fabriqué ?
Des ressources peuvent nous aider à choisir, comme la toute jeune application Clear Fashion, sorte de Yuka du vêtement, des sites ou des blogs (Happy New Green, Planet Addict, Mes courses pour la planète, SloWeAre ou The Green Eyes) qui répertorient les marques éthiques et compilent les bons conseils. L’un des premiers réflexes reste néanmoins de savoir décoder les étiquettes.



Comment choisir à l’achat ?
Étiquettes et labels
Avant de se lancer dans l’examen détaillé de celle-ci, le prix peut être un indice fiable. Même si pas cher ne signifie pas forcément de mauvaise qualité, on reste dubitatif devant des prix plus que bradés… Un vêtement étant le produit d’un savoir-faire, qu’est-ce qu’un tel montant indique sur le salaire des ouvriers qui l’ont fabriqué et sur la valeur de sa matière ?
Depuis le Rana Plaza, nous prêtons attention au lieu de fabrication de nos vêtements… Made in China, India, Portugal, Italy ou Spain ? Les règles n’y sont pas les mêmes tant sur le plan humain qu’écologique. Mais la transparence n’est pas toujours au rendez-vous. La loi n’oblige pas les marques à donner toutes les informations sur les étiquettes. C’est pourquoi certaines se contentent d’indiquer la composition. Beaucoup n’affichent clairement ni l’origine des matériaux, ni le lieu de production, ni l’impact écologique de leurs produits. Avez-vous déjà remarqué la mention Création française ? Piège pour le consommateur distrait, elle ne signifie pas du tout que le vêtement a été fabriqué dans l’Hexagone, simplement que le bureau de stylisme y siège… Regardez, elle est souvent suivie de Made in China.
Même si une fabrication européenne rassure, elle ne met pas à l’abri de mauvaises surprises. Les réseaux sociaux ont vu éclater quelques scandales, certains concernant des marques aussi prestigieuses que Prada, dont des chaussures portaient le sigle Made in Italy. Si elles étaient bien assemblées dans le pays de la botte, les matériaux n’en étaient pas originaires. De plus, un atelier lointain n’est pas forcément synonyme d’abus, et on peut aussi travailler dans de mauvaises conditions en Europe… Les experts le rappellent : il ne faut pas hésiter à se renseigner sur la marque avant un achat et à poser toutes les questions possibles au vendeur. N’oublions jamais qu’un consommateur est un acteur économique majeur !
Il y a de quoi se sentir perdu. Heureusement, des labels permettent au simple Béotien d’évaluer l’impact environnemental des textiles sans trop d’érudition ni de mal de tête.
Selon la sociologue Majdouline Sbai, auteur d’Une mode éthique est-elle possible ?, le Global Organic Textile Standard (GOTS) reste le plus complet. Il assure du caractère biologique des fibres (produites sans pesticides ni OGM) et de « la responsabilité du point de vue social et environnemental de la transformation et de la fabrication textile ». On peut également se fier à Oeko-Tex, créé en 1992, qui s’est imposé comme le leader mondial de la labellisation santé – il garantit en effet que le textile ne contient pas de produits toxiques. Suivi de la mention Standard 1000, il témoigne du respect de l’environnement. Un troisième, Fairtrade/Max Havelaar, concerne le commerce équitable (transparence de la chaîne de production, juste rétribution des producteurs et usage de coton équitable). Citons aussi l’Ecolabel européen, Demeter, Naturtextil, ESR-Ecocert Equitable,… Pour les matières animales, comme la laine, le label Cruelty Free assure qu’à aucun moment l’animal n’a souffert, que la tonte par exemple s’est faite à la main. Enfin, au niveau européen, on encourage actuellement la promotion d’un affichage environnemental, comme il en existe déjà pour les machines à laver, ce qui nous permettrait de savoir si une chemise est notée A+ ou E-.
L’étiquette comporte toujours un renseignement de taille : la composition du vêtement. Quelles matières choisir ? Il en existe trois grandes familles : les fibres naturelles (végétales ou animales), les synthétiques et les artificielles. A priori, on voterait volontiers pour les premières. Mais notre bon sens nous oriente-t-il vers le choix optimal ?
Tour d’horizon des matières
Si l’on compare les émissions de gaz à effet de serre des deux fibres les plus courantes, le coton (fibre végétale) et le polyester (fibre synthétique dérivée du pétrole), le premier semble en effet meilleur pour la planète : la production d’un t-shirt en polyester génère 5,5 kilos de gaz à effet de serre, contre 2,1 kilos pour un t-shirt en coton.
Au polyester, qui rejette de petites particules de plastique au lavage (nous y reviendrons), s’ajoutent d’autres matières synthétiques peu recommandables comme le polyamide (Nylon), le polyuréthane (spandex, Lycra, élasthanne), le Gore-Tex (sauf s’il est assuré sans PFC ou composés perfluorés) ou l’acrylique. Entre la nocivité de leur procédé de fabrication et leur caractère non biodégradable, mieux vaut les éviter. Néanmoins, si vous n’avez pas le choix, du 100% polyester sera 100% recyclable et pourra devenir du PET ! On trouve d’ailleurs des polaires en plastique recyclé.
Et attention ! Derrière le coton, associé à la nature, au bien-être et à la douceur, se cachent en réalité bien des méfaits. Les études récentes fournissent de quoi ébranler notre confiance. Après le riz et le blé, il se positionne comme le troisième plus gros aspirateur d’eau d’irrigation du monde. La production d’un simple t-shirt requiert en moyenne 2 700 litres d’eau, soit le volume qu’une personne consomme en 3 ans, en plus de 150 grammes de pesticides… Une telle dépense de ressources naturelles remet en perspective le prix de ce grand classique de la garde-robe. Comme nous l’avons vu plus haut, cette plante tropicale fragile dévore 25% des pesticides à l’échelle mondiale… Résout-on le problème avec le coton bio ? Sans pesticides, il nécessite 50 à 60 % moins d’eau que le coton conventionnel, ce qui est nettement préférable, mais représente encore moins de 1 % des surfaces mondiales destinées à la production.
Certains rêvent d’abandonner la culture du coton. L’économiste américaine Pietra Rivoli l’analyse même comme le résidu d’une civilisation fondée sur l’esclavage. Mais pour le moment, si fibre naturelle ne signifie pas forcément fibre écoresponsable, le coton recyclé et le coton bio représentent une alternative possible pour le consommateur.
Pour faire face aux excès du coton, le prêt-à-porter s’est tourné vers des matières artificielles (ou semi-synthétiques), fabriquées à partir de la cellulose de plantes.
Laissons de côté la viscose (ou rayonne), élaborée à partir de copeaux de bois (notamment de bambou), qui requiert des procédés toxiques pour sa fabrication, participe à la déforestation massive de forêts anciennes en voie d’extinction et génère un immense gâchis en eau (il faut 4 000 à 11 000 litres d’eau pour 1 kg de viscose). Misons plutôt sur le lyocell (ou tencel, dont la production demande 5 fois moins d’eau que le coton), produit à partir d’eucalyptus, de feuillus ou de bambou ; le cupro, fabriqué à partir de résidus de coton ; ou le modal, issu du bois de hêtre… Toutes ces matières bénéficient d’atouts majeurs, à savoir leur caractère biodégradable et économique en eau. Souples, elles sont également agréables à porter.
Comme souvent, les créateurs et les fabricants se tournent vers le passé pour redécouvrir les bienfaits des plantes d’autrefois. Le lin s’est retrouvé propulsé chouchou des blogs tendance green. Le chanvre est une piste explorée par Lacoste ou par Levi’s pour ses jeans. L’ortie, qui ne pique plus une fois transformée, sort de l’oubli. Les trois possèdent le fort avantage d’avoir de faibles besoins en eau. Très résistantes, elles nécessitent aussi moins de pesticides et peu d’engrais. La France étant le premier producteur de lin, autant en profiter !
Si certains parient sur la nostalgie, d’autres inventent l’avenir. Dans les locaux de Fashion For Good à Amsterdam, des start-up ont développé de nouvelles matières comme le dimpora, la première membrane imperméable biodégradable qui a remporté la seconde place du Global Change Award 2019. Le recyclage des déchets alimentaires constitue également une piste privilégiée. Outre le recyclage des fibres déjà existantes, la mode du futur puise également dans les déchets alimentaires. Cuir fabriqué à partir de feuilles d’ananas (Piñatex) ou de champignons (Mycoworks), tissu créé à partir de marc de café, robe élaborée à partir de pelures d’orange… L’imagination sauvera le monde !
Qu’en est-il des matières animales ? En 1994, la campagne de PETA s’en prenait à la fourrure. « We’d go rather naked than wear fur », disait le slogan (« Je préfèrerais être nue plutôt que de porter de la fourrure »). Un autre problème a désormais été mis en évidence. En 2012, Envol Vert a révélé qu’une paire de chaussures en cuir sur 7 en France était issue de la déforestation… En effet, le cuir se trouve souvent corrélé à l’élevage intensif des bovins en Amérique du Sud… Et si l’on se penche sur les fibres d’origine animales, on s’expose à d’autres déconvenues. La laine, friande d’eau (12 litres d’eau pour 1 kilo de laine brute), nécessite aussi des produits polluants pour son traitement. Heureusement, une fois encore, la laine recyclée permet de contourner le problème. Les associations de protection animale pointent également du doigt des méthodes maltraitantes, comme l’arrachage sur les petits lapins Angora en Chine (des problèmes ont été aussi signalés en France), le mulesing sur les moutons en Australie (on découpe la queue et la peau sur leur arrière-train pour lutter contre des infections liées aux mouches) ou la castration des chèvres pour le cachemire en Inde et en Mongolie, où le surpâturage accélère au passage la désertification des steppes ! Pour ces raisons, il est préférable de se rabattre sur le mohair (issu de la chèvre Angora, pas du lapin) ou l’alpaga. Dans un autre genre, on peut aussi investir dans de la soie à condition qu’elle soit labellisée.
Reste la question des teintures, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds ou des allergènes, et des produits toxiques utilisés pour imperméabiliser, empêcher les plis, lutter contre les moisissures et les champignons, réduire l’inflammabilité des tissus ou tanner le cuir. Difficile de lutter contre cela. C’est pourquoi il est vivement recommandé de laver ses vêtements neufs avant leur première utilisation et de guetter les mentions « sans solvant » ou « teinture végétale » et la présence de labels comme Oeko-Tex ou Écolabel européen. Ceux-ci certifient que les substances dangereuses ne sont plus présentes lors de la vente.
Face aux abus, une réponse radicale serait d’arrêter la fabrication de nouveaux tissus dans les conditions actuelles. Mais en attendant que les marques traditionnelles fassent leur transition, vers quel type de vêtements se tourner ? On l’a vu, on ne peut qu’encourager le développement des fibres recyclées (y compris les synthétiques et la fourrure), encore trop peu utilisées (elles représentent seulement 1% de la production actuelle). Dans les faits, d’autres possibilités existent déjà. Les propositions concrètes ne manquent pas, comme la vogue florissante du Do it yourself ! Si vous n’êtes pas doués en couture, pas d’inquiétude, pour sauver la planète, vous avez l’embarras du choix.
Les choix alternatifs
Le classique : le vintage et la seconde main
La fripe est-elle le remède à la surconsommation ? Qu’on le trouve en dépôt-vente, sur des vide-greniers, dans des vide-dressings ou sur les sites communautaires (Vinted, Vestiaire Collective…), le vêtement d’occasion, qu’il soit de seconde main ou vintage, fait de plus en plus d’émules. En 2017, 53 % des Françaises y ont eu recours. À l’horizon 2050, le chiffre d’affaires engendré par la seconde main pourrait même dépasser celui de la fast fashion ! En plus du plaisir de la chine, de la bonne affaire et de la belle trouvaille, ce marché s’est paré d’une autre vertu. Comme l’expliquent Nathalie Dolivo et Katell Pouliquen dans leur enquête sur le Rétro-Cool, comment le vintage peut sauver le monde : « auparavant perçu comme un moyen pour moins dépenser, le vintage s’inscrit désormais dans une logique de consommation responsable. » En plus de servir de rempart à la pollution, de faire apprécier le savoir-faire des couturières du temps jadis – quand on porte du vintage, on se rend compte à quel point les vêtements étaient doublés et les tissus bien plus résistants –, la fripe apporte également à ses adeptes la satisfaction de la distinction et de la singularité, ajoutent les journalistes. La chine, ou comment donner du chien à son look…
La nostalgie, c’est bien, mais la mode trouve aussi son sens dans la création. A-t-on vraiment envie de se limiter au passé, qui d’une part risque de sanctionner les créateurs, et d’autre part, de nous priver du plaisir de l’inventivité ? Comme le souligne Cécile Zeitoun, la créatrice de Zeit Paris Berlin, dont nous parlerons plus bas, « pourquoi associer l’idée de faire le bien à la restriction et à la privation ? Pourquoi ce qui est bon au goût et procure du plaisir devrait-il être forcément mauvais pour la santé et le bien-être ? »
En effet, nous pouvons d’ores et déjà nous orienter vers des marques éthiques, soucieuses de l’environnement et des principes de l’économie circulaire. Le seul hic, c’est qu’il faut partir à leur recherche. Moins visibles, elles sortent des sentiers battus de la grande distribution et pratiquent parfois des prix plus élevés. Mais l’enjeu n’en vaut-il pas la peine ?
Une valeur montante : l’Upcycling
Avez-vous entendu parler de l’upcycling (ou surcyclage), l’art de faire du neuf avec du vieux ? Basé sur le principe de l’économie circulaire, ce mode de production propose d’éliminer la phase de fabrication de textile et de retravailler des pièces de seconde main ou des matériaux récupérés, souvent destinés à la déchèterie. Et voici bien des problèmes éliminés et bien des ressources économisées. « C’est attaquer le colosse de biais », témoigne Anaïs Dautais Warmel, la fondatrice des Récupérables, fan de fripes et partisane d’une sobriété heureuse. Chaque saison, sa marque, qui connaît une belle expansion, propose dix modèles intemporels à prix raisonnables fabriqués à partir de rideaux et de tapisseries, de stocks de fabricants de tissus ou de fin de rouleaux de marques. Elle vient d’ailleurs d’inaugurer une première collection homme cet automne et une première boutique à Paris. « C’est une solution ponctuelle à un problème colossal, qu’on pourrait résoudre en atteignant le zéro déchet. Mais il serait utopique de penser qu’on peut ne plus fabriquer de tissus. En tout cas, s’il faut être patient pour trouver les meilleures solutions, on a le devoir d’exiger en tant que consommateur de la transparence et de remettre une échelle de valeur derrière chaque produit. On peut en quelque sorte voter avec sa carte bleue ! » Dans ce contexte, l’upcycling apparaît comme une solution réaliste pour résoudre le problème posé par l’équation actuelle.
Dans un style différent, Gaëlle Constantini, pratique le genre depuis dix ans. Après avoir transformé de luxueux draps d’hôtel en robes d’été, elle a récemment imaginé une collection à partir de rideaux du Sénat.
Ces deux créatrices participent également à l’économie solidaire. Elles font réaliser leurs collections en France dans des ateliers d’insertion qui accompagnent des apprentis ou des professionnels en situation d’exclusion ou de précarité. Autre spécialiste de l’upcycling, Céline Zeitoun réutilise pour sa marque Zeit Paris Berlin des chutes de grandes maisons de couture et réinvente un lien privilégié avec ses clientes. Elle a opté pour le local entre une boutique à Paris et un atelier de fabrication en région parisienne, ce qui lui permet de remettre le travail de création au centre, sans se soucier d’un rythme imposé par les collections, et de proposer de la demi-mesure sur ses modèles.
De nouveaux jeans
Parmi les représentants de la fast fashion, le jean fait figure de mauvais élève. Un jean et ses composants parcourent en moyenne 65 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre ! Cela équivaut à l’utilisation de 25 litres de pétrole… Et comme si cela ne suffisait pas, il faut l’équivalent de 285 douches pour en obtenir… un ! En cause, des techniques comme le sablage et d’autres procédés chimiques qui donnent un aspect vieilli ou délavé au denim… Autant investir dans un modèle brut, non artificiellement troué, qui se patinera avec les années. Des marques sont passées à l’ozone, à la lumière ou au laser pour éviter le gâchis des ressources naturelles et les produits toxiques (en général, elles le spécifient). En France, 1083 (soit le nombre de kilomètres qui séparent les deux villes françaises les plus éloignées) a relocalisé la fabrication de jeans, à partir de l’étape du filage, dans le périmètre de l’Hexagone. La marque néerlandaise MUD travaille à partir de fibres de cotons recyclées et d’après son fondateur, elle a divisé par 70% la consommation d’eau par rapport aux jeans classiques. Sa compatriote G-Star Raw a lancé, en association avec Pharell Williams et Parley for the Oceans, une collection de denims composés à 45% de fil recyclé à partir de détritus plastiques des océans.
L’outsider : le vegan
Si manger vegan permet d’épargner bien des animaux, s’habiller vegan peut-il changer le cours des choses ? Pour l’instant, mettre de côté le cuir, la laine et la fourrure par souci écologique reste encore du domaine de la niche. Mais certains exemples montrent que le vegan peut sortir de ce statut. Si Stella McCartney milite pour le vegan dans le luxe, Veja a su se démarquer en proposant, parmi l’ensemble de ses collections, un choix de modèles de baskets 100% vegan. Néanmoins, en dépit de ce succès, on reproche souvent au cuir vegan son coût, sa fragilité et son fini. Vegan n’est pas non plus toujours synonyme de durable, ni de zéro déchet. En effet, bien des matières synthétiques proviennent de la pétrochimie et peuvent contenir du plastique ! Ici aussi, il faut se méfier des prix bas…
L’avant-garde : la location
Les enseignes qui se lancent dans la location de vêtements font encore figure de pionnières, même si les candidats à l’aventure se multiplient. Le Closet, SFSK, spécialisé dans les vêtements éco-compatibles, Rent the Runway ou Nuuly, la plateforme de location d’Urban Outfitters… La plupart fonctionnent sur abonnement. Le concept séduit également des marques comme Bocage, qui, depuis fin 2018, propose à ses clientes de louer leur modèle de chaussures préféré pour une durée de deux mois.
Néanmoins, les tentatives ne se prolongent pas toujours. L’Habibliothèque, créée en 2014, a fermé récemment, malgré une bonne presse, de la visibilité, des abonnées fidèles et des collaborations avec les Galeries Lafayette.
La location se heurte ici aux mœurs. Est-on prêt à louer une robe ou un pantalon comme on en a pris l’habitude pour une voiture ou un appartement ? Selon Maeva Bessis, rien n’est encore tranché. « On peut y croire, et j’ai envie d’y croire, mais il faut en parler au maximum. Le business basé sur l’utilisation, et non sur l’acquisition et la possession, a de l’avenir. »
Vous retrouvez votre souffle ? Le pari n’est pas fini. Pour sauver la planète, nous devons nous comporter en héros au quotidien – conscients, informés et responsables. Si notre pouvoir d’achat représente un levier puissant, la manière dont nous prenons soin de notre penderie en est un également. 50% de la pollution générée par le secteur de l’habillement dépend en effet de la seconde phase de vie des produits. Après l’achat, la conservation…
Comment entretenir ses vêtements ?
Attention, ce qui va suivre remet en question un acte aussi anodin que celui de faire sa lessive !
En 2012, Greenpeace a analysé des échantillons de vêtements de marques comme Zara, Levi’s ou Armani, dans lesquels se trouvaient des substances toxiques appelées éthoxylates de nonylphénol (NPE). Or, l’ONG a établi que leur lavage puis leur mise en décharge provoquent le rejet de NPE qui se dégradent ensuite en une substance très nocive, le nonylphénol (NP). Ce perturbateur endocrinien contamine ensuite les sédiments et les nappes phréatiques pour se retrouver dans la chaîne alimentaire. Le film d’horreur continue quand on apprend que le fameux demi-million de tonnes de microfibres plastiques versé dans les océans est issu du lavage de fibres aussi courantes que le polyester, le Nylon ou l’acrylique !
Le mal est fait. Comment rebondir ?
Si on ne peut revenir en arrière, il nous reste à changer nos habitudes pour des gestes simples comme laver le linge à basse température à 30° ou 40°, éviter l’option séchage, choisir une lessive écologique sans parfum, oublier les adoucissants parfumés, limiter au maximum le nettoyage à sec, aérer ses vêtements, les nettoyer à l’envers, attendre que le panier de linge sale soit suffisamment plein pour remplir le tambour de la machine. Autant de manières d’économiser de l’énergie et les ressources en eau. On peut également faire soi-même sa propre lessive à partir de lierre ou de savon de Marseille (à choisir sans glycérine et bio).
Avec fermeté et humour, Anaïs Dautais Warmel pointe du doigt une dictature de l’hygiénisme. « Au fond, pourquoi a-t-on besoin de laver un vêtement ? Si le vêtement ne sent pas mauvais, pourquoi le mettre d’office à la machine ? Quand on était petit, cela ne nous posait pas de problème de porter plusieurs fois le même habit. » S’il y a juste une petite tâche, faisons l’effort de la nettoyer à la main ! Les remèdes des grands-mères et des costumières sont aussi les bienvenus. La terre de Sommières se révèle très efficace contre les taches de graisse, le sérum physiologique contre le sang, le bicarbonate contre les teintures accidentelles – si vous lavez des t-shirts clairs avec des chaussettes rouges… Enfin, appliquons à notre penderie la philosophie japonaise du kintsugi, qui consiste à réparer un vase ébréché avec de l’or, et reprisons, recousons nos vêtements troués !
La fin de vie des vêtements représente aussi un enjeu crucial. En effet, sur le nombre de pièces mises sur le marché en France chaque année, on en retrouve seulement 30% dans le circuit du recyclage. Les militantes insistent sur ce point, contrairement aux idées reçues, même des vêtements tachés ou usés peuvent resservir. Dans les conteneurs, tous les textiles sont les bienvenus, linge de maison compris, le but de l’opération étant d’éviter la poubelle. Des sites comme La fibre du tri répertorient les points de collecte dans toute la France. Certaines marques, comme A.P.C., proposent de récupérer leurs anciennes pièces pour les recycler en échange d’un avoir, d’autres ont créé, comme Petit Bateau ou Cyrillus avec Seconde Histoire, leur plateforme de revente et d’achat entre particuliers.
Faisons donc barrage à l’obsolescence programmée ! Retrouvons de l’espoir en mettant fin à l’économie linéaire et à son schéma produire, vendre, jeter, et en participant à la vitalité de l’économie circulaire ! Qu’on croie ou non à ces solutions, la prise de conscience écologique nous pousse à changer nos habitudes et influe sur notre comportement comme sur notre manière d’être. La planète semble nous réclamer un travail sur nous…
Vers une nouvelle manière d’être ?
Depuis une décennie, de nouvelles valeurs émergent. Décroissance, simplicité et frugalité se retrouvent de plus en plus mises en avant, au détriment de l’achat compulsif dépeint désormais comme une addiction moderne. Le courant de la slow fashion, à rebours de la fast fashion, fait son chemin jusque dans les magazines de mode.
Dans notre quotidien, l’accumulation ne fait plus rêver, elle devient même synonyme d’encombrement. Comment expliquer autrement le succès de la méthode Konmari mise au point par Marie Kondo ? L’édition de poche affiche fièrement sur son bandeau « plus de 5 millions de lecteurs conquis ». Autant d’individus qui entrevoient dans le rangement une promesse de bonheur ? Dans ses ouvrages, Marie Kondo invite chacun à faire un tri dans son armoire en se demandant pour chaque habit : qu’est-ce qu’il me fait ressentir ? On garde ceux qu’on aime porter, et on remercie le reste, ces objets dont on ne sert jamais mais que l’on stocke « au cas où ». Dans la lignée des philosophies de la pleine conscience, du Care et du Less is more (Moins, mais mieux), on s’éloigne ici des concepts du in et du has been, en prônant le retour aux basiques, en préférant la qualité à la quantité, le ressenti à l’apparence, et le soin au gâchis. Pour contrer la tendance, cultivons chacun notre style personnel, qui nous rend unique. Montre-moi comment tu t’habilles, je te dirais qui tu es. Plutôt que de nous cacher derrière une tonne de vêtements et d’accessoires, le vestiaire contemporain idéal participe à l’affirmation de soi.
Bien des réponses se trouvent en effet au rayon développement personnel. Vous vous sentez sceptique ? Tout ceci vous semble être le symptôme d’un surmoi moralisateur ? « Il ne s’agit pas de se culpabiliser, poursuit Anaïs Dautais Warmel, mais d’apprendre à se questionner : est-ce bien pour moi et pour autrui ? Si l’on n’est responsable de rien, comment être responsable de son propre bonheur ? » Le travail sur soi et sur ce que nous portons et achetons nous confronte à bien des interrogations… qui peuvent se révéler très utiles sur tous les plans. Clotilde Dusoulier, auteur du podcast Change ma vie, dans l’épisode « Arrêter d’attendre », prend l’exemple d’une robe en vitrine qu’on a très envie d’acheter. Qu’est-ce qui stimule ce désir ? À juste titre, analyse-t-elle, ce sont les émotions et le bien-être qu’on imagine éprouver une fois celui-ci assouvi. Mais ne peut-on pas ressentir la même chose autrement ?, demande-t-elle. Sortir de la compulsion névrotique, c’est également apprendre à faire face à ses frustrations à l’ère du « je veux tout et tout de suite ». Parmi les classiques du développement personnel, Dominique Loreau, adepte du minimalisme, dans son livre L’art des listes, propose de noter ses envies dans un carnet… Et de voir si quelques jours plus tard, elles sont toujours là. Dans d’autres ouvrages, comme L’art de la simplicité, elle recommande également de choisir des vêtements qu’on peut porter au moins 8 mois par an ou de limiter sa garde-robe à un nombre fixe de pièces : à chaque nouvelle qui entre, une ancienne sort… De quoi réfléchir à deux fois avant de céder à la pulsion d’achat !
Conclusion
« Buy less, choose well, make it last » (« Achète moins, choisis bien, fais-le durer »), nous conseille la styliste britannique Vivienne Westwood. Faisons de son adage le nôtre. Pour ne pas nous sentir coupables, devenons responsables ! C’est peut-être l’un des meilleurs remèdes à l’abattement et à la collapsologie. Par nos actions, nous n’éviterons sans doute pas les changements climatiques, mais nous pouvons au moins essayer de les ralentir. Et gardons en tête que le phénomène de la fast fashion ne date que d’une génération… Nous pouvons faire autrement, tant qu’il est encore temps.

2/3 des Français déclarent avoir acheté des vêtements qu’ils ne portent jamais… Et chaque année, nous jetons 12 kg de vêtements !