
CONVERSATION
Corinne Morel-Darleux,
Jean-Marc Gancille
Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ?
Interview et rédaction : Flora Clodic-Tanguy
Photographies : Alys Thomas
Leur grille de lecture et leur radicalité face aux effondrements en cours et à venir se répondent. Leurs deux livres sont sortis quasiment au même moment, dans un format similaire, court et incisif. Terra Incognita a proposé à Jean-Marc Gancille et à Corinne Morel-Darleux de se réunir le temps d’une interview (en amont du confinement), pour évoquer leurs constats et leurs engagements. Au-delà de la prise de conscience, lucide et digne, ils appellent à la désobéissance et à l’action collective.
Terra Incognita : Vos points de vue et vos manières de raconter sont assez complémentaires. Avez-vous un mot à vous dire tous les deux pour commencer ?
Jean-Marc Gancille : J’avais été assez troublé de la similitude de réflexion sur le sujet qui nous rassemble, en voyant tes contributions, Corinne, sur les réseaux. Cet échange a été l’occasion de lire enfin ton livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Même s’il est très différent sur la forme, liée à tes mots, ton parcours, ta sensibilité, le fond est extraordinairement convergent ! La référence aux Racines du Ciel de Romain Gary m’a touché profondément… C’est mon ouvrage fétiche, une inspiration très forte qui guide en partie ce que je fais aujourd’hui.
Corinne Morel-Darleux : Moi, c’est ton éditeur qui m’a offert Ne plus se mentir, après un débat avec Alain Damasio, à Paris, persuadé que ça allait me parler… Cette rencontre a précipité la lecture. Certaines parties se recoupent. Ton livre fait aussi tout ce que j’avais la flemme de faire et je suis très contente que tu l’aies fait ! La partie sur les faits, les constats, les exemples, que je trouve assez forts, sur pourquoi nous sommes dans une sacrée impasse, et pourquoi nous ne pouvons pas juste compter sur une prise de conscience, les petits gestes ou le réveil des entreprises. Je ne sais pas si c’est un préalable au mien ou une suite, mais les deux sont vraiment complémentaires. Ce n’est pas anodin qu’on ait aussi choisi la même forme. J’étais très attachée à ce qu’on puisse le lire rapidement, le glisser dans une poche et qu’il ne coûte pas trop cher.
Jean-Marc : Tout à fait. Le tien est plus « littéraire », plus poétique, que le mien. Plus introspectif peut-être. Quand Thomas Bout m’a contacté pour me proposer de faire ce livre aux éditions Rue de l’Échiquier, j’étais en colère par rapport à ce que j’entendais, qui me semblait être des illusions, des impasses, de la pensée magique, des faux chemins. Il lançait Les Incisives, une nouvelle collection à vocation plus pamphlétaire, pour casser les idées reçues, poser des constats implacables et ça m’allait bien. Il a fallu rappeler des faits pour dérouler ma pensée. C’était aussi le moment où Nicolas Hulot jetait l’éponge, un déclencheur qui nous a tous marqués, de près ou de loin. Ce petit format était celui d’un cri.


TI : C’est la première fois que vous échangez. Pouvez-vous revenir chacun sur votre parcours ?
Corinne : Je tente la version condensée ! Après une école supérieure de commerce, j’ai été plusieurs années consultante pour les multinationales du CAC40.
Jean-Marc : Pareil !
Corinne : J’ai fini par démissionner… J’avais besoin de trouver une utilité sociale dans mon activité quotidienne. Je me suis occupée des écoles de la Mairie des Lilas, en Seine-Saint-Denis, j’ai tenu une galerie d’art contemporain… Des choses assez différentes ! Et en 2008, j’ai quitté Paris pour m’installer dans la Drôme. Alors que je pensais me mettre en retrait et cultiver mon jardin, j’ai été rattrapée par la possibilité de développer l’écologie au sein de la direction du Parti de Gauche, à sa création.
Pendant dix ans, j’ai vraiment tenté la voie institutionnelle et partidaire, avec des responsabilités nationales, beaucoup de travail à l’international et sur l’écosocialisme, les questions de climat et de biodiversité. J’en suis à mon deuxième mandat de conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un peu plus d’un an, j’ai démissionné de la France Insoumise, dans laquelle je ne me retrouvais plus, puis de la direction du Parti de Gauche.
J’ai écrit mon bouquin cet été-là, entre ces deux démissions. J’arrivais dans une impasse sur ces voies politiques que j’avais tentées. Je voyais aussi une autre impasse dans laquelle on était en train de s’engouffrer, sur les questions de climat et de biodiversité et de risques d’effondrement. J’avais besoin de mettre sur le papier le résultat de ces dix années de réflexion et la bifurcation que je vivais en termes d’engagement politique. J’avais aussi besoin d’essayer, sans doute, de le magnifier par la littérature et la poésie, pour ne pas sombrer.
Jean-Marc : Pourquoi as-tu quitté la voie partidaire ? Qu’est-ce que tu n’y trouvais plus ?
Corinne : Il y a d’abord un facteur personnel d’usure. C’est un engagement très prenant. Je n’avais plus le temps de vivre et je ne m’appartenais plus vraiment. Il y avait de plus en plus un hiatus entre ce que je ressentais de la gravité et de l’urgence de la situation et les réponses qu’on pouvait apporter dans le cadre d’un parti qui se présente aux élections. J’étais aussi prise dans un tourbillon, entre la visibilité médiatique obligatoire, les polémiques sur les réseaux sociaux et les histoires internes, les conflits d’égo, les rapports de pouvoir… Autant de temps et d’énergie qui n’est pas utilisé pour agir.
Mener une stratégie de conquête du pouvoir par les urnes me semble de plus en plus illusoire. Le gouffre, le fossé avec la grande masse des électeurs et des citoyens me semble de plus en plus infranchissable. Penser qu’on va faire la révolution en distribuant des tracts m’apparaît de plus en plus comme une fable qui n’est pas à la hauteur de la situation…
TI : Jean-Marc, est-ce que tu veux réagir et partager ton parcours ?
Jean-Marc : Je suis aussi entré dans la voie de la gestion, du management, de l’école de commerce, mais j’ai très vite senti que ça ne me convenait pas. Pour mon premier boulot, j’ai eu la chance d’intégrer un groupe de réflexion associatif – le CIME (Comité d’Information et de Mobilisation pour l’Emploi) – qui avait vocation à faire réfléchir les entreprises du CAC40 à leur rôle dans la Cité. Une revue m’a aussi apporté le sens que je n’avais pas encore trouvé : Transversales Science-Culture. Pendant ces quelques années au CIME, j’ai pu me familiariser avec de nouvelles logiques : comment être attentif à son territoire, s’ancrer dans un bassin d’emploi, aider les jeunes à s’y insérer, entreprendre autrement via l’économie sociale et solidaire, etc. Ça m’a donné l’espoir naïf qu’on pouvait transformer l’économie…
C’est la raison pour laquelle j’ai intégré France Télécom, à Bordeaux. J’avais trouvé ce poste pour explorer ma double conviction de l’époque : exercer mes compétences en communication et marketing, mais avec du sens, avec ma casquette de directeur du développement durable. De 2000 à 2007, j’ai œuvré là-bas, avec beaucoup de cœur et d’énergie, principalement sur des programmes d’appui à la biodiversité, de l’empreinte carbone des portables, d’appui aux plans de mobilité pour les salariés, en parallèle d’un boulot plus classique de communicant.
Le grand écart m’est apparu de plus en plus, entre les moyens et le crédit qui m’étaient donnés pour ce que j’estimais essentiel, et ce qui était alloué pour vendre toujours plus et faire tourner le cœur de la machine, surtout sans changer le logiciel ! La boite avançait, mais de pire en pire. Je voyais démantelée une vraie culture du service public, jusqu’à cette période sombre, étalée dans les journaux, cette pression sur les hommes et les femmes pour quitter le navire, avec des méthodes managériales détestables.
Je suis parti avec le grand plan de départs volontaires. C’était le bon moment : j’ai croisé Philippe Barre, alors à la tête d’une agence de publicité. Il voulait m’embarquer pour changer les pratiques des boîtes en matière de communication responsable, mais aussi pour un projet qu’il avait en tête… Deal! Il est devenu mon associé et le fameux projet est devenu Darwin, sur les quais de la Garonne. En dix ans, nous avons conceptualisé, mis en œuvre, développé ce lieu qui est vraiment magique, qui fait chaque année la preuve de son originalité et de sa puissance au moment du Festival Climax.
Nous avons expérimenté dans tous les sens, sur l’autonomie énergétique, l’agriculture urbaine, l’alimentation, le management participatif, la transversalité… Un laboratoire de transition exceptionnel pour moi. Nous pensions que nous pourrions faire pour nous ce qu’on n’avait pas réussi à faire pour nos clients…Au bout de dix ans, j’ai du m’y résoudre : la transition que j’espérais dans la société avait échoué. Nous avons eu aussi notre lot d’usure, de fatigue, de tensions liées à un bras de fer permanent avec les collectivités et les promoteurs immobiliers… J’ai décidé de quitter Darwin pour me consacrer au sujet qui me semble le plus vital : le biocentrisme et l’anti-spécisme, mon utopie politique.
Je vis aujourd’hui à la Réunion. Je travaille dans une association de protection des cétacés, Globice. J’ai la chance d’être au contact des baleines et des dauphins tous les jours, un rêve ! Je mène aussi plein d’actions, auprès de l’Association végétarienne de France, de Wildlife Angel, une ONG de lutte contre le braconnage en Afrique, d’un collectif de lutte contre la captivité des animaux et pour leur réhabilitation dans le monde sauvage.



TI : Et ton rapport à la question politique ?
Jean-Marc : Je suis issu d’une famille très aimante mais pas du tout politisée. Plus jeune, je n’avais pas vraiment de convictions conscientisées. Je suis devenu un lecteur assidu de La Décroissance, qui m’exaspère comme il me ravit, intransigeant sur les idées, à rebours de la complaisance qui nous arrange. Beaucoup plus tard, la découverte de l’éco-socialisme a beaucoup résonné avec l’évolution de mes idées. J’ai choisi la voie associative et entrepreneuriale. Dans ce monde politique, il y a une forme d’inertie, de logique du compromis permanent, à la fois en interne, dans la structure et avec son électorat et avec l’opposition, qui me paraissait trop difficile à vivre et à conduire.
Corinne : Je ne voudrais pas non plus donner l’impression de renier mon passé partidaire ! Ces dix années ont été très formatrices pour moi – et utiles au-delà, je crois. Et je continue à trouver une vraie noblesse à siéger à la région face à la majorité de Laurent Wauquiez, pour porter la voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Je continue à penser que c’est utile, mais le hiatus entre cette forme d’action et l’urgence, la gravité de la situation devient trop important. J’adorerais y croire encore, mais je ne pense plus qu’on puisse y arriver de cette manière-là.
Jean-Marc : Je partage ce sentiment. J’ai des amis, à gauche comme à droite, qui croient dur comme fer à ce qu’ils font avec sincérité et noblesse. Un engagement sans faille que je pense indispensable et utile pour qu’il y ait encore des digues… Je constate aussi, que comme toi, ils s’épuisent et n’arrachent que des toutes petites victoires qui me semblent tellement loin de ce qu’il faudrait aujourd’hui accomplir. C’est une voie qui me semble usée et obsolète, face à un risque de vie ou de mort imminent.
“La politique, c’est une voie qui me semble usée et obsolète, face à un risque de vie ou de mort imminent.”
TI : Pouvez-vous réexpliquer clairement le risque et l’urgence de ces effondrements ? Sur quoi faut-il « ne plus se mentir » et « refuser de parvenir », comme vous y invitez chacun ?
Jean-Marc : Les alertes des scientifiques se multiplient et nous le sentons désormais dans notre chair : nous arrivons à des points de bascule qui risquent de nous plonger dans un état irrémédiable de dévastation, d’un point de vue du climat et de la biodiversité. Les taux de concentration de CO2 dans l’atmosphère, la disparition des espèces, les migrations : tout ça se percute…
Face à ces constats indiscutables, au-delà de l’aveuglement, du déni, de la surdité, le plus grave pour moi est la volonté de s’en accommoder, par un pouvoir qui détient la puissance d’imposer son rythme et ses vues et n’a que faire de l’intérêt général. Cette confrontation entre l’urgence de l’essentiel et ce cynisme qui tend à se répandre me paraît insupportable.
Corinne : Je ne sais pas si je suis en train de basculer dans la catégorie « vieux cons » ou si c’est réel, mais j’ai l’impression qu’il y a aussi une espèce de dévissage culturel généralisé de la société. Une perte d’honnêteté intellectuelle, de réflexion, d’exigence d’un minimum de tenue et d’élégance dans tous les domaines, et notamment en politique. Je suis effrayée de voir arriver au pouvoir des gens comme Donald Trump et Jair Bolsonaro ou de constater la tonalité utilisée sur les réseaux sociaux.
Ce dévissage va de pair avec d’autres facteurs de vulnérabilité de la société, sur le plan des flux de marchandises et des flux financiers mondialisés, interconnectés et très dépendants du numérique. Tout ça ressemble de plus en plus à un château de cartes. Il suffit d’un rien pour se retrouver avec un effet d’effondrement en domino.
Le risque d’effondrement n’a jamais été aussi probable et aussi critique. Quand j’étais consultante, on évaluait les risques autour d’un projet en fonction de leur probabilité mais aussi de leur criticité (leur gravité si ça arrive) et de la vulnérabilité. Si un risque était peu probable, mais très critique, on arrêtait le projet. Aujourd’hui, on est exactement dans ce cas-là !
Comme Jean-Marc le dit aussi, je ne suis pas capable de savoir exactement ce qui va se passer, à quel moment, s’il va y avoir un effondrement, dans combien de temps, quelle forme il va prendre… En revanche, je sais que la criticité est déjà redoutable. Pas en 2050, pas en 2100, aujourd’hui ! C’est aujourd’hui que la biodiversité s’éteint, qu’on est à pieds joints dans la destruction du vivant. Il n’y a plus la moindre décence commune dans la manière dont nous vivons.
Alors, oui, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus continuer comme ça. Ceux qui ne se sentent pas percutés par ça et ne se sentent pas obligés de se poser des questions, de faire des pas de côté, sont en train de passer à côté d’un risque terrible, pour tout le monde.
Jean-Marc : On accuse les responsables nationaux ou les grandes multinationales de nos turpitudes actuelles mais ce que je trouve aussi très affligeant, c’est de retrouver ce même cynisme chez nos élus locaux. Ils ont pourtant la charge d’assurer l’intérêt général, de prévenir les risques et d’assurer une forme d’égalité sur les territoires. Leur inaction est pour moi quasi-criminelle.
À Bordeaux, j’ai été proche d’Alain Juppé, dans le dialogue. Je trouvais ça dingue qu’un homme avec un tel parcours, l’accès à toutes les informations, les réseaux et les sources à activer pour comprendre et agir en connaissance de cause, n’ait rien fait. Est-ce à cause de son formatage, des dogmes qui nous enferment ou qu’il a intentionnellement laissé le système filer, continuer, voire l’a encouragé ? Cela me laisse pantois, perplexe, indécis et triste.
Corinne : Je suis d’accord. Les responsabilités ne sont pas toutes les mêmes. Je le dis dans mon livre : nos ennemis sont ceux qui savent, ont des leviers et ne font rien.
TI : On sent dans vos prises de parole et dans vos livres beaucoup de colère et de tristesse. Nourrissent-elles vos actions ?
Corinne : Dans les débats publics sur ces questions-là, je vois de plus en plus de gens qui ont lu les livres de Pablo Servigne ou d’autres auteurs, mais découvrent presque la collapsologie avant d’avoir exploré l’écologie politique. Ils sont très peu « outillés » et sont encore très centrés sur leurs émotions et ce que ça leur fait… Je leur dis souvent que la meilleure consolation, c’est l’action, car c’est par elle et par la lutte collective qu’on arrive à dépasser les émotions individuelles.
Ma colère à moi est très fortement teintée de tristesse… C’est aussi ce qui m’a poussée à écrire. C’est un combat assez ingrat tant nous sommes minoritaires et les victoires sont difficiles à arracher. Nous avons besoin de trouver des raisons de continuer à lutter. Il y a toujours un dixième de degré ou une espèce d’invertébré à sauver, un hectare de terre à empêcher d’être bétonné. Et puis il y a aussi cette « dignité du présent », pour se rappeler qu’on ne mène pas seulement les combats pour les gagner à la fin mais parce qu’on les pense justes.
Rester digne et debout en tant qu’être humain, continuer malgré tout, envers et contre l’air du temps, à essayer de faire les choses avec un petit peu d’élégance, de gratuité du geste et de dignité, c’est pour moi une des meilleures thérapies.
Jean-Marc : Cette « dignité du présent » est importante pour moi aussi. Dans la conclusion de mon bouquin, j’ai dit « pour l’honneur », mais je voulais dire la même chose. Je crois que c’est tout ce qui nous reste. La colère, c’est le corollaire d’une forme de passion, de la vie, d’une certaine exigence. C’est aussi le pendant de mes convictions, que j’ai envie de diffuser et de voir s’incarner, se concrétiser.
Quand tu vois comme les choses sont lentes, comme on a un ressac contraire, comme c’est décourageant, cela ne peut susciter rien d’autre que de la colère… Pas canalisée, elle peut se transformer en invective, en violence, en joutes infinies. Mais elle n’est pas en soi un sentiment négatif. Elle peut aussi amener à se dépasser et se transformer dans l’action collective.
Je trouve très saine la collapsologie car elle dit les choses tout en réveillant une forme de peur et d’angoisse, qui pousse à réagir. Je n’ai jamais aimé ces discours écolo où il fallait toujours positiver. Oui, il faut une écologie punitive aussi !
Corinne : On a un point commun très fort tous les deux, c’est de vouloir arrêter de parler d’espoir et de recommencer à parler de courage. C’est ce discours d’Extinction Rebellion qui m’a attirée : le fait de dire « arrêtez avec ces histoires d’espoir, d’être positifs, de ne pas faire peur aux gens, etc. » Je crois que cette phase-là est derrière nous et qu’il s’agit de faire preuve aujourd’hui de lucidité et de courage.
Jean-Marc : Ça avance pas mal là-dessus ces derniers mois. De plus en plus de gens sont dans le même état d’esprit. Ils ont bien conscience qu’ils étaient endormis.

TI : Même si notre impression est aussi liée à nos bulles de filtres, comment expliquez-vous le réveil de ces derniers mois ?
Jean-Marc : Les militants pacifiques, au sein d’Extinction Rebellion notamment, font l’expérience de l’arsenal répressif de l’Etat, de plus en plus violent. Le mouvement des Gilets Jaunes a aussi contribué à révéler la vraie nature de ce pouvoir, pas si différente de ce qu’on peut voir, au Brésil, aux États-Unis ou aux Philippines.
Pendant des années, on a été hyper complaisants, gentils, pacifiques. On a fait des marches, des pétitions et le pouvoir n’a changé en rien… Il nous a juste enfumés un peu plus. On a atteint les limites du pacifisme, de la gentillesse, de la conscientisation, de l’obéissance. Pour bon nombre de personnes, on ne sait pas exactement ce qu’il faut faire après, mais on a atteint le point de non-retour.
Corinne : Je suis d’accord, il y a une forme de continuité. La destruction du vivant est de plus en plus visible. Elle rattrape les gens sur leur lieu de vie. Entre les Alpes qui s’effondrent, le lac d’Annecy qui s’assèche, les périodes de vendanges qui changent, la disparition des abeilles et d’un certain nombre d’oiseaux… tout ça devient palpable et flippant, et pour beaucoup plus de personnes.
Des gens qui jusqu’ici avaient délégué leur puissance d’agir à des représentants politiques, à des organisations écolo ou environnementales, ont envie de passer à l’action. Ceux qui étaient déjà dans l’action se rendent compte que tout ce qu’on a essayé jusqu’ici n’a pas fonctionné. Les seules réactions qu’on obtient en face, c’est davantage de répression. Plein de croyances avec lesquelles on a grandi, y compris en tant que militants, sont en train de s’effondrer, comme celle de la culture du nombre ou du rapport de force. On a toujours pensé que si on était très nombreux au même moment, au même endroit, le gouvernement serait obligé de nous entendre. Qui peut encore croire ça ?
Si on nous avait dit il y a 10 ans qu’il y aurait 2 millions de signataires pour une pétition comme l’Affaire du Siècle et qu’il ne se passerait rien en face, on aurait peut-être gagné 10 ans ! Cette idée de mouvement de masse n’est plus adaptée à notre époque, au type de pouvoirs politiques avec lesquels on doit composer. On a en face de nous une collusion entre les intérêts économiques, médiatiques et politiques qui appelle d’autres formes d’actions.
Tout ça provoque l’émergence d’autres mouvements, d’autres profils militants et d’autres envies d’action.
TI : De nouveaux mouvements politiques émergent, qui remettent aussi au goût du jour d’anciennes théories et pratiques, comme l’anarchisme ou l’écoféminisme. Quel regard portez-vous sur ce bouillonnement ?
Corinne : J’ai vraiment la conviction profonde que le centre de gravité de l’action politique s’est déplacé, des partis, des syndicats et des modes d’action traditionnels vers d’autres milieux, anarchistes, libertaires, zadistes… Je les fréquente aussi plus depuis un an, il y a peut-être un effet de loupe ! Ce bouillonnement, dans ces milieux-là, dans plein de nouveaux réseaux et dans leurs médias indépendants, n’existait pas auparavant. Ça réfléchit, ça débat, ça réagit… Le mouvement des Gilets Jaunes est venu renforcer ce qui commençait à frémir.
L’Etat est tellement défaillant sur toutes ses missions, à commencer par la première d’entre elles – se porter garant de la solidarité nationale – en privatisant les biens communs, en abandonnant nombre de services publics… que la vision de l’État souverain, providentiel, s’est effondrée. Cela induit la montée en puissance d’un certain nombre de courants politiques qui réfléchissent et s’organisent pour faire sans État !
L’expérience du Rojava en Syrie du Nord vient alimenter toute cette réflexion et m’intéresse beaucoup. J’y suis allée deux fois, pour voir comment un territoire et ses habitants peuvent s’organiser dans une situation de conflit armé, de pénurie généralisée, sans État, avec un projet révolutionnaire, féministe, écologiste, socialiste.
Je retrouve dans tout ça l’espèce de bouillonnement intellectuel et politique que j’ai connu il y a 10 ans, au début du Parti de Gauche. Avec des réflexions différentes mais avec ce même appétit de débat de fond, d’actions de terrain. Ça me fait un bien fou en tout cas de retrouver ça.
TI : Ce qui change, c’est aussi la manière d’envisager l’action militante, notamment en termes de désobéissance et de violence…
Corinne : Dans la situation actuelle, écarter la dégradation des infrastructures et des biens matériels ne me parait pas possible en tant que position de principe. Cela peut être une stratégie à un moment donné et on a besoin, aussi, d’actions non-violentes, ne serait-ce que pour des questions de montée en gamme et en intensité. Tout le monde ne va pas commencer par aller saboter des engins de chantier de Vinci juste après avoir lu un bouquin de Pablo Servigne !
Surtout, arrêtons de croire qu’on va tous se mettre d’accord sur les mêmes tactiques et modalités d’action. On n’est pas tous câblés pareil, on ne vit pas dans les mêmes conditions matérielles d’existence, on n’a pas tous les mêmes possibilités ni les mêmes envies. Il faut accepter cette diversité.
J’aime beaucoup cette phrase de Derrick Jensen : « Cela veut dire que les différentes branches d’un mouvement de résistance doivent fonctionner en tandem : les organisations à visage découvert et les organisations clandestines, les militants et les non-violents, les activistes en première ligne et les travailleurs culturels. Nous avons besoin de tout le monde. » On a besoin d’une stratégie coordonnée mais pas forcément d’un mode d’action unique. Ça serait même une erreur de le chercher à tout prix.
Jean-Marc : Au-delà des manifestations des feux de forêt, de la canicule, des migrants, etc., ce qui explique l’effet de cliquet, c’est l’effondrement de la représentation et de l’imaginaire qu’on nous avait inculqué de ce qu’était l’État, en tant que corps politique sensible à l’argumentation et au bien commun et qu’on pourrait finalement ramener à la raison pour garantir l’intérêt général, avec une avant-garde éclairée. L’idée des Lumières d’aller vers un État garant du bien commun n’a peut-être jamais été juste, mais elle est morte. Les grandes puissances le montrent : on est plutôt dans le règne des intérêts particuliers et court-termistes, qu’on poursuit de manière irresponsable…
Une fois qu’on a dit ça et qu’on en prend pleinement conscience, s’affranchir de cette domination, de cet autoritarisme, nous amène vers des idées libertaires et anarchistes. Et quand on s’y intéresse, on voit à quel point elles ont été à l’avant-garde de combats d’émancipation et de libération en tous genres (éducation, féminisme, écologie…) et on ne peut qu’adhérer.
Ce regain de curiosité et de bouillonnement intellectuel prend des formes diverses selon notre culture politique ou notre maturité par rapport à ces idées. Certains y arrivent tout juste, d’autres les expérimentent depuis des années. C’est une source de joie, de fraîcheur. Ça fait passer un peu de lumière.
Quant au couple violence/non-violence, quand j’ai lu le livre Peter Gelderloos [ndlr : philosophe libertaire, activiste et théoricien anarchiste] Comment la non-violence protège l’État ?, ça a été un choc ! Le constat est implacable et se démontre tous les jours. Il faut dorénavant une diversité de tactiques et on n’y parviendra pas par la conscientisation, l’obéissance, le processus démocratique. Il faut encore des pacifistes, des marches, des pétitions. Mais il faut aussi des organisations clandestines, qui recourent à d’autres moyens, non pas pour nuire à l’intégrité physique des personnes, pour commanditer des attentats et du terrorisme, mais pour arrêter cette machine infernale qui détruit tout sur son passage et qui sans interposition physique continuera son chemin.
Si on a tant de morts en Amazonie ou dans certains pays africains, notamment de militants écolos, c’est qu’ils sont confrontés concrètement à ça. Ils s’interposent parce qu’ils n’ont plus le choix. Et le combat est impitoyable. Ici, nous sommes encore dans une forme de confort, d’intellectualisme. Nous sommes encore préservés de ça, mais nous n’aurons bientôt plus le choix. Cela pose la question qui me taraude : « Jusqu’où chacun d’entre nous est prêt à aller ? », à se mettre en danger par rapport à cette destruction du monde, qui concerne à la fois chacun d’entre nous et le collectif dans lequel on s’insère.
“On a atteint les limites du pacifisme, de la gentillesse, de la conscientisation, de l’obéissance.”
TI : Et vous, jusqu’où êtes-vous prêts à aller ?
Corinne : C’est une vraie question… J’ai relevé une phrase dans Ne plus se mentir, que j’ai trouvé utile d’écrire, au moins une fois : « Personne de sain et de responsable ne rêve de violence. » Et c’est vrai… ça n’est pas de gaieté de cœur que je dis que l’État a failli à ses responsabilités et qu’on ne peut plus se contenter de marches pacifiques et de pétitions… Je préfèrerais que ça soit encore le cas.
La diversité des tactiques et des actions suppose aussi de ne pas confondre radicalité et radicalisme rigide. La brochure récente Défaire le radicalisme rigide est intéressante par rapport à ces phénomènes d’hostilité horizontale, de la manière dont on est capables les uns les autres de se taper dessus alors qu’il y aurait vraiment d’autres choses à faire… Et comme je le dis souvent, « on est toujours le bisounours ou le black bloc de quelqu’un », donc il faut se prémunir des jugements hâtifs.
« Jusqu’où aller ? », je me pose la question quasiment tous les jours. Ma situation est un peu particulière : je suis élue de la République et je peux probablement me permettre de dire plus de choses que plein de citoyens “lambda”. Je n’hésite pas dans mes interventions à dire publiquement qu’il faut qu’on passe à des actions de blocage, de sabotage, qui permettent de ralentir la destruction du vivant, de la biodiversité, des terres arables etc. Elles ne sauveront pas la planète. Elles ne renverseront pas le système. Mais elles nous laissent au moins une chance de construire autre chose, et d’être capables de reconstruire après un effondrement.
Pour l’instant, comme sur d’autres aspects plus éthiques que révolutionnaires, mon engagement est de faire des ponts entre tous ces réseaux-là, alerter, débloquer des situations pour que des actions puissent voir le jour et être les plus efficaces et les plus sincères possibles.
Cela implique aussi d’y participer, ça fait partie pour moi de l’éthique de la radicalité. Il n’y a rien dans ce que je dis que je ne sois pas prête à faire ou que je ne fasse pas déjà.
Jean-Marc : Ce que dit Corinne résonne, mais je vais d’abord appliquer à moi-même mon injonction de « ne pas se mentir »… Je considère que je suis encore vraiment dans un confort bourgeois. Je sais que ce que j’ai fait et initié jusqu’à présent n’est pas à la hauteur du défi et de ce qu’il faudrait faire. Je réalise que je n’ai pas forcément les compétences et le courage de m’interposer physiquement comme cela me semble nécessaire dans certains cas.
Je n’ai pas envie de me le cacher et cela m’interpelle, parce qu’on est beaucoup trop nombreux dans ce cas-là. Ça m’empêche de dormir parfois, parce que je pense qu’on est loin d’être à la hauteur des défis de notre époque, moi le premier… En revanche, j’y réfléchis, je me documente, je prends des contacts et je pense qu’il va falloir dépasser un jour l’action symbolique.
Ceux que je fréquente et revendiquent cette forme d’activisme, qui sont issus des mêmes milieux que le mien, voire partagent les mêmes convictions, sont tous dans l’activisme symbolique, y compris ceux d’Extinction Rebellion. Coller des empreintes sur l’Assemblée nationale, déverser du sang, bloquer une matinée une succursale de banque, ou bloquer une mine chaque année une journée en Allemagne comme un grand happening environnementaliste, ça ne change rien…
Existe-t-il des organisations clandestines dont j’ignore l’existence et qui font des choses en sous-main et qui bloquent, hackent, détruisent ? Peut-être, mais je n’en ai pas l’impression, et c’est aussi une interrogation. On connaît certaines têtes de pont, certaines publications, les velléités de certains réseaux. En revanche on n’entend jamais parler d’actes de sabotage vraiment radicaux au sens où on en parle aujourd’hui. On ne les voit pas ou alors il y a une omerta médiatique.
Corinne : Ce qui est sûr, c’est que faire émerger ces mouvements-là n’est pas si simple ! Notre société a beaucoup perdu de sa culture de résistance. On est tout juste en train de réintégrer nos corps. Dans notre société aseptisée, il y a peu de contacts physiques, de rugosités, de frictions. Ceux qui ont le temps de se poser ces questions et ont les conditions matérielles d’y passer du temps sont plutôt des gens qui ont grandi dans des milieux petits bourgeois, confortables, et n’ont pas la culture d’aller s’exposer à ces risques… La plupart des gens n’ont pas de souvenirs de conflits armés ou de pénuries généralisées. Ce n’est pourtant pas si vieux !
Quand je vais en Syrie du Nord ou dans d’autres endroits, c’est différent. Les militants sont dans des mises en danger bien plus fortes que chez nous, même si la question de la violence physique revient en France dans les quartiers populaires et par le biais de la répression policière…
Je ne suis pas très étonnée qu’il y ait si peu de passage à l’acte. Intellectuellement, c’est surprenant mais pratiquement et matériellement, c’est assez logique. Trouver un cercle affinitaire suffisamment de confiance pour mener clandestinement des actions illégales, qui ne s’improvisent pas, demandent matériel, préparation, logistique, organisation et comportent des risques importants en matière de répression judiciaire, c’est plus que difficile dans une ambiance répressive qui fait tout pour dissuader ce type d’actions.
TI : Nous pourrions faire une interview sans fin, mais il est bientôt temps de nous arrêter ! Et si, pour terminer, vous vous posiez vous-mêmes les questions ?
Jean-Marc : S’il ne devait y avoir qu’un seul engagement prioritaire, ça serait quoi ?
Corinne : Je vais répondre par deux, qui pour moi sont en lien : « politiser la collapsologie » et « remettre du beau dans la politique ». Et toi, Jean-Marc ?
Jean-Marc : Pour moi, c’est « étendre notre considération à toutes les espèces », en premier lieu celles dont on connaît la sentience, la sensibilité, la capacité à ressentir de la douleur et l’envie de vivre. Cette « utopie biocentrique » est fondamentale. Elle répond à des problématiques éthiques profondes et à des intérêts écologiques. On sait à quel point l’élevage est nuisible, qu’il soit intensif ou extensif, aux écosystèmes, pas simplement industriels.
Jean-Marc : Et sinon, tu me conseilles quel livre que je n’aurais pas lu ?
Corinne : Ça sera un livre de littérature alors, pas un essai ! Dans les dernières choses que j’ai lues ou relues, je te conseille L’homme qui savait la langue des serpents, d’Andrus Kivirähk. Ce roman estonien contemporain se passe au XIIIe siècle, en Estonie, au moment où les colons allemands arrivent avec le christianisme forcé et l’agriculture.
On suit les quelques païens qui vivent encore dans la forêt, les derniers êtres humains qui savent la langue des serpents, hibernent et ont des échanges philosophiques avec eux… Un univers mythique (et pas mystique !) où cette déconnexion d’avec le vivant n’a pas encore eu lieu. Les obscurantistes de la forêt en prennent pour leur grade autant que les colons.
C’est un univers complètement magique, où les ours sont des êtres naïfs et libidineux qui flirtent avec les femmes humaines, où il y a des combats sanglants, un grand-père qui chasse les vents pour les mettre dans des sacs et les réutiliser dans des batailles.
On peut lire ce roman au premier degré : c’est palpitant, il y a des personnages, des histoires d’amour, des rebondissements… On peut aussi en faire une lecture politico-philosophique.
Jean-Marc : Je vais plutôt te donner un essai, qui m’a bouleversé récemment. Derrick Jensen, Zoo : le cauchemar de la vie en captivité. C’est une réflexion sur nous-mêmes, pas simplement sur ce constat de domination insupportable et de maltraitance qui perdure. Il est très concis et se lit vite. Très chouette.
Corinne : J’ai tendance à faire des cauchemars, je t’enverrai ma facture si je termine chez le psy !
Jean-Marc Gancille, Ne plus se mentir, Petit exercice de lucidité par temps d’effondrement écologique, Editions Rue de l’Echiquier, février 2019
Corinne Morel-Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l’effondrement, Libertalia, juin 2019
Notre monde est en transition. Cette transition est écologique, économique, énergétique, politique, sociale, …
Cette transition va tout changer.
Mais si la transition vers le pire a réussit à capter les imaginaires, une autre transition est possible.
Cette crise globale est l’occasion de changer nos modèles pour créer la société que nous désirons : pour penser une nouvelle économie, une nouvelle démocratie, une nouvelle relation à la planète, de nouveaux droits de l’Homme et du vivant.
Mais pour que cette nouvelle société soit plus éthique, il faut être acteurs de ce monde en transition… non pas parce que nous avons trop à y perdre, mais parce que nous avons trop à y gagner.
C’est la mission de Terra Incognita que d’aller à la rencontre des acteurs de ce monde en transition.

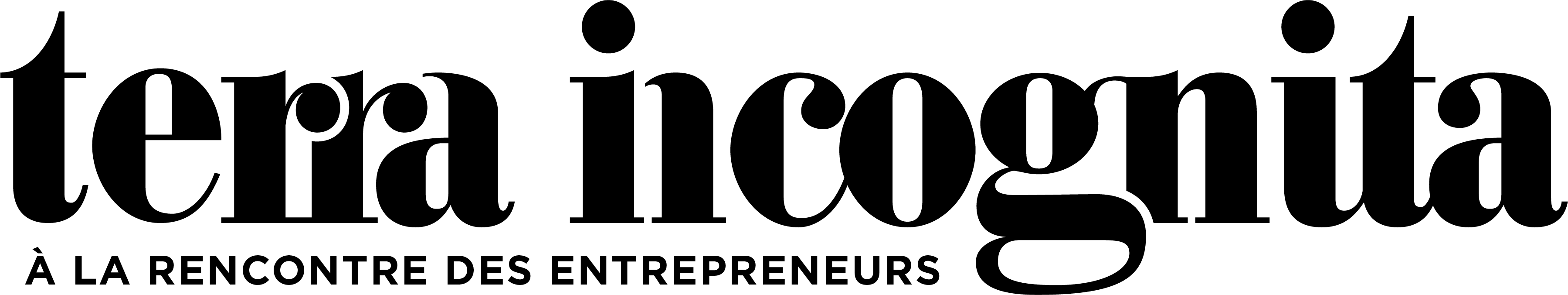

voilà 2 êtres soeurs et frères dans l’âme … mais ils ne sont pas tout seuls …. merci pour cette belle interview profonde et sensée, à tous les deux. Après avoir dévoré Jean-Marc, je vais dévorer celui de Corinne !