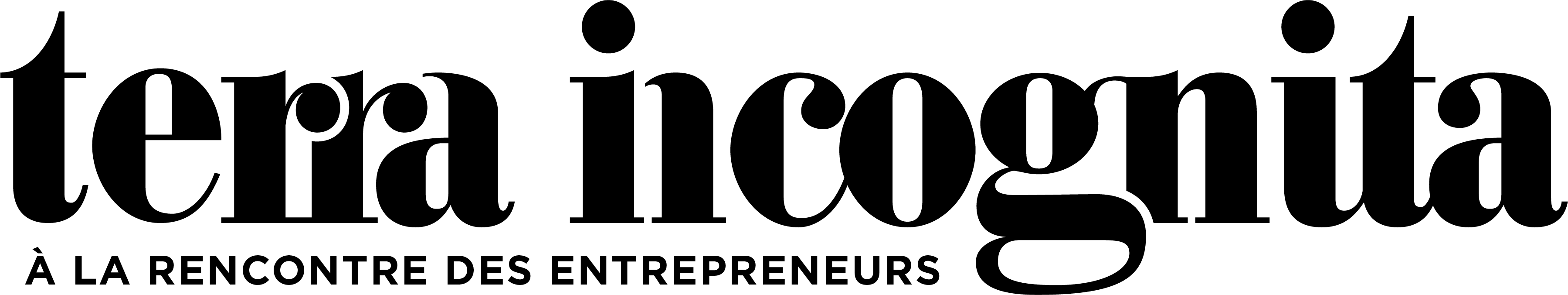CULTURE
Nicolas Doucet
SONY PLAYSTATION
Le « Monsieur Réalité Virtuelle » de Sony PlayStation
Interview et rédaction : Jean-Samuel Kriegk
Photographies : Valentin Pringuay
TERRA INCOGNITA ∞ ● THIS IS NOT THE MEDIA YOU’RE LOOKING FOR
La réalité virtuelle (VR) est la dernière révolution en date du jeu vidéo. Il faut l’avoir expérimenté pour en être convaincu : la profondeur de champ infinie, la stéréoscopie, la vision périphérique à 360° transforment radicalement l’expérience de jeu et permettent des innovations qui commencent à peine à être imaginées. D’abord plutôt réservée au monde PC, la VR se décline aujourd’hui en version console sur une seule machine : la PlayStation. Avec un relatif succès pour l’instant : le casque PlayStation VR s’est déjà vendu à plus de 3 millions d’exemplaires. Chez Japan Studio, le studio tokyoïte de développement des jeux exclusifs à la console de Sony, la recherche et développement pour la réalité virtuelle à destination de ce casque a été confiée à une petite équipe : la Team Asobi, dont le prestige et la renommée sont grandissants. A sa tête, un jeune Français de quarante ans : Nicolas Doucet, manage une équipe internationale.
Ses premiers concepts convainquent tellement Sony qu’une série de mini-jeux gratuits (PlayRoom VR) lui est commandée pour accompagner la sortie du casque en octobre 2016, avant que lui soit confié un véritable jeu d’une douzaine d’heures. Astro Bot: Rescue Mission, sorti le 4 octobre 2018, enthousiasme tous les joueurs qui ont pu l’essayer. Ils témoignent unanimement d’une véritable révolution dans cet univers déjà par nature disruptif qu’est la réalité virtuelle.
Nicolas Doucet en est à la fois le producteur et le directeur artistique. De passage en France pour la Paris Games Week, nous avons eu la chance de pouvoir passer plus d’une heure et demie en sa compagnie afin de comprendre comment un jeune Français a réussi à s’imposer à la tête de l’équipe en charge de l’activité la plus stratégique de la plus grande marque de gaming au monde. Rencontre avec un intrapreneur aussi doué que modeste.
Comment a commencé votre parcours dans le jeu vidéo ?
Je suis parti travailler en Angleterre à l’âge de 18 ans, avec déjà un lien lointain avec l’univers du jeu vidéo que j’avais découvert plus petit : j’ai grandi avec la première console de Nintendo que j’ai eue à l’âge de 12 ans. A cette époque les jeux n’étaient pas traduits en français : il fallait un dictionnaire pour comprendre l’anglais. Un outil qu’on nous demandait d’utiliser à l’école, ce qu’on n’avait jamais envie de faire. Mais à partir du moment où c’était pour jouer, cela m’intéressait beaucoup. Vers 15 ans, j’avais du vocabulaire, plutôt tourné vers l’heroic fantasy mais rare. Du coup, ça m’a fait aimer la langue et j’ai eu envie de devenir professeur d’anglais. Je suis parti à Londres avec en tête l’idée d’y rester entre six mois et un an. J’ai d’abord trouvé un boulot dans un café puis au bout d’un an j’ai eu la chance incroyable qu’un ami me montre une offre d’emploi de l’éditeur Eidos. C’était l’époque de la première PlayStation. J’ai postulé en ligne et dès le lendemain mon téléphone a sonné. C’était un autre Français, qui m’a fait passer un entretien d’à peine quinze minutes par téléphone avant de me demander si je pouvais démarrer le lendemain ! J’ai accepté et suis parti au Nord de l’Angleterre pour travailler sur un jeu de foot. Je devais trier les commentaires : par exemple “Bonne passe” pouvait être mis fréquemment tandis que “Oh la la, il lui a démonté la clavicule !” ne devait pas être entendu plus d’une fois tous les cinq matches pour ne pas faire trop de répétitions. C’était déjà du game design, mais vraiment de base ! (rires) J’ai fait quelques petites missions de trois à six mois chez Eidos, puis chez Electronic Arts dans le sud de Londres, dans une compagnie qui s’appelle Bullfrog où j’ai travaillé avec Peter Molyneux, aujourd’hui reconnu comme un grand artiste du jeu vidéo.

Le lieu de la rencontre avec Nicolas Doucet, le Reset Bar un bar consacré au gaming en plein coeur de Paris (17, rue du Cygne, 75001 Paris)
Plus tard vous avez travaillé chez Lego. Que faisiez vous là-bas ?
J’y suis arrivé en 1998, dans une nouvelle filiale : Lego Media qui faisait des jeux PC. Lego n’était alors pas du tout intéressé par l’univers consoles. C’était une compagnie familiale, et l’univers PC permettait ce rapprochement avec celui de la famille : on installait les jeux sur l’ordinateur de papa. Ils avaient alors besoin de gens pour faire des tests afin d’identifier tous les bugs et les faire remonter vers les programmeurs pour qu’ils les corrigent. C’était un job permanent et c’est pour ça que je l’ai choisi. Après Bullfrog j’ai vraiment hésité car Lego n’était alors pas une société reconnue pour le jeu vidéo. Mais je ne l’ai jamais regretté car il y avait une culture d’entreprise fantastique ! Lego n’a jamais trahi ses valeurs : la qualité est très importante chez eux, de même que le respect du consommateur. A l’époque la brique de Lego venait de tomber dans le domaine public. N’importe quel concurrent pouvait vendre des briques compatibles. Lego s’est donc retrouvé face à plein de concurrents arrivant sur le marché avec des clones quatre fois moins chers et de mauvaise qualité, et perdait de la vitesse. Sur notre intranet, on voyait la courbe de Lego face à ses concurrents, et elle baissait chaque jour… Ils n’avaient pas peur de nous le montrer, d’autant qu’ils refusaient de renoncer à leurs valeurs familiales. Lego refusait par exemple de mettre des armes dans les mains de leurs figurines. Je me suis dit qu’on entendait parler de business tout le temps, mais qu’il continuait d’exister des entreprises focalisées d’abord sur leurs valeurs plutôt que la recherche du profit immédiat, ça m’a fait beaucoup de bien.
En 2004 vous rejoignez Sony Playstation Europe pour travailler sur EyePet…
Lego était en train de passer au jeu sur consoles. J’ai travaillé un peu sur Lego Star Wars puis la société a déménagé au nord de l’Angleterre et je n’avais pas envie de suivre. C’était déjà dur d’être à Londres. J’ai commencé à chercher un autre job et suis parti chez Sony. Je m’attendais à tomber dans une boite d’électronique, mais en fait pas du tout. C’était l’époque de la PlayStation 2 et deux concepts allaient se lancer : EyeToy, un jeu familial où il faut gesticuler devant la caméra, et Sing Star, un jeu de karaoké. Finalement, de Lego à ce Sony là il y avait très peu de différences. C’était toujours du jeu vidéo familial, accessible, et social.
Du coup, vous vous retrouvez chez PlayStation à travailler sur les prémices de la réalité augmentée sur EyeToy. Ce qui vous a amené à vous spécialiser sur le sujet ? Car ensuite vous avez travaillé sur EyePet.
En effet, EyeToy c’est déjà de la réalité augmentée – même si aujourd’hui on n’en a pas l’impression – puisqu’on met l’image filmée du joueur dans le jeu. Mais le respect des tailles et des proportions n’était alors pas important, c’était juste du fun. L’étape suivante est intéressante : au lieu d’amener le joueur dans un monde virtuel, on amène une dimension virtuelle dans son salon. C’est EyePet : un petit animal domestique virtuel qu’on rajoute dans le salon filmé par la caméra. On peut le caresser et il a des réactions. Là il fallait soigner les proportions, c’était une vraie évolution de la réalité augmentée.
Ensuite, vous partez au Japon travailler sur PlayRoom, comment cela se passe ?
Playroom était une évolution du même concept pour le lancement de la PlayStation 4 (PS4). Né en 1978, je suis de la génération qui a été influencée par la culture japonaise avec la télévision. En Angleterre les influences étaient beaucoup plus américaines avec Tortues Ninja par exemple. Lorsqu’on abordait les références de personnages, les cultures étaient vraiment différentes. Il y avait donc déjà chez moi un affect pour le Japon. Ensuite j’ai rencontré mon ex-femme à Londres, qui était japonaise. En sortant d’EyePet, j’avais un peu de lassitude, l’envie d’essayer quelque chose de différent. J’ai envoyé un email à notre Président Sohei Yoshida. C’est une personnalité emblématique de PlayStation : sur les réseaux sociaux c’est un peu le visage de la marque. Mes patrons de l’époque me l’ont reproché car je les ai carrément sautés. Mais lui fonctionnait comme ça. Je lui ai écrit que j’étais en Angleterre, que j’avais de la famille et que je voulais venir au Japon. Et le week-end de l’envoi de mon mail, il me répond “OK” ! Puis il envoie un second mail avec en copie ma hiérarchie. Le lundi quand je suis arrivé au travail, l’ambiance était un peu particulière… Le deal c’était d’y aller au moins trois ans, à moi de trouver là-bas comment avoir de l’impact. Mais la première année a été difficile : à peine arrivé s’est passé le tremblement de terre de 2011.

Ce sont donc essentiellement des raisons personnelles qui vous ont amené à Tokyo, pas un projet ?
Exactement. Il y a d’ailleurs eu un autre déclic un peu bizarre. A Londres j’ai assisté en promenant mon fils à une dispute entre une mère et ses enfants. Je me suis dit que je ne voulais pas le faire grandir dans une ville comme çà : à la maison il était dans un cocon et dans la rue il a vécu une sorte de choc. Je savais qu’au Japon il y a plus de sérénité. A cinq ans, les enfants vont seuls à l’école et la communauté veille sur eux.
De l’extérieur on imaginerait facilement l’inverse : vous travaillez à Londres sur les projets de Sony qui préfigurent la VR, puis vous rejoignez l’équipe prestigieuse de Japan Studio pour avancer sur le casque PlayStation VR
C’est l’inverse… En arrivant là-bas il fallait trouver un moyen d’apporter une plus-value. J’aurais été incapable de travailler sur un jeu de course ou un jeu de flingues… En arrivant, j’ai découvert le projet de caméra équipant la PS4 et je me suis tout de suite demandé comment on pourrait l’utiliser.
Dans quel contexte développez-vous le projet Playroom ? Est-ce vous qui amenez le projet ?
Lorsque je suis arrivé chez Japan Studio, le studio de Tokyo qui développe les jeux exclusifs à la PlayStation, ils avaient eu de gros succès avec des jeux d’auteur comme Ico ou Shadow of the colossus. Le studio avait développé cette patte. Mais le management a changé juste après mon arrivée avec un nouveau directeur : Alan Becker, qui avait fondé le studio Santa Monica, responsable notamment de God of War ou Journey. Pour moi ça a été une aide énorme. Il s’est tourné vers moi et m’a demandé de voir quoi faire avec la caméra. C’est là que j’ai pu connecter avec mon expérience précédente, recruter une petite équipe d’ingénieurs pour faire de la recherche développement et des démos de jeux.
Et c’est devenu PlayRoom
C’est ça : ces petites démo techniques nous ont permis de comprendre ce qu’il était possible de faire avec cette nouvelle technologie. A nous mais aussi aux autres studios, y compris externes à Sony : ils avaient besoin de voir ce qu’il était possible de proposer sur la PS4 et laisser libre cours à leur imagination. On a fait le tour du monde des studios pour montrer nos premières démo, vraiment moches et basiques mais fun à jouer.

Cela fait penser à l’approche de Nintendo
Je n’ai pas honte à le dire : c’est complètement ça. On a donné un nom à notre équipe : Asobi. Cela veut dire “jouer” en japonais au sens le plus large. ça vient aussi de l’expérience Lego, qui est un mot danois pour dire la même chose : “jouer bien” dans le sens positivement et intellectuellement. C’était l’esprit dans lequel on voulait travailler : réfléchir au coeur de ce que doit être le divertissement, partager aussi avec ceux qui ne pratiquent pas le jeu vidéo. Nos démos ont finalement intégré la PS4 pour que les utilisateurs puissent avoir cette expérience accessible et inclusive en effet très Nintendo dans l’esprit. Chez Sony, il y a beaucoup d’ingénieurs excellents mais qui ne savent pas forcément ce qui est fun. Ces gens là font de la technologie. De l’autre côté il y a des studios de jeux vidéo très bons. Entre les deux il n’y a pas forcément de communication. Il manquait au moment où les ingénieurs développaient la console ces retours pour aiguiller leurs choix techniques. L’idée initiale en montant l’équipe Asobi n’était pas de faire du jeu vidéo, c’était de proposer une sorte de kit R&D dédié au fun. Et ça c’est la logique de Nintendo : avoir des groupes pour planter des graines qui vont faire pousser des forêts de fun ! Ensuite, on s’est trouvé à faire des jeux par accident car les gens trouvaient nos démos super cools. C’est encore une fois Sohei Yoshida qui a poussé.
Du coup, assez naturellement Sony vous associe à son projet VR. Vous êtes game director sur The Playroom VR, associé au lancement du casque PlayStation VR quelques années plus tard
Rebelote ! Le prototype de casque arrive sous le nom de code Morpheus. Au départ je n’étais pas convaincu : on partait d’un concept très inclusif pour faire jouer les gens ensemble et arrive ce casque très isolant. Notre premier challenge a été de mettre plusieurs personnes sur un sofa, pour qu’ils se passent le casque et jouent avec. Les jeux très immersifs, qui font peur, on s’est dit que 90% des développeurs allaient en proposer. Ça ne nous intéressait pas. C’est de là qu’on est parti sur le concept de Playroom VR : on s’est dit que tout le monde avait une télé, et qu’on pouvait s’en servir comme d’un deuxième écran. Cette fonctionnalité n’était pas prévue au départ ! Elle n’existait pas. On est allé voir les ingénieurs de Sony : l’avantage de vivre au Japon, c’est qu’on est à côté. On a fait du hacking avec une PS Vita qu’on a relié à la PS4 qui envoyait deux jeux différents, de façon asymétrique, aux deux écrans. Puis a relié la Vita à la télé, et on leur a montré que si on pouvait faire en sorte que le téléviseur montre autre chose que ce qu’on voit dans le casque, on pouvait faire jouer 5 à 6 personnes à un jeu social que personne n’avait inventé avec la VR. Ainsi, les ingénieurs ont accepté de modifier le hardware pour nous.

C’est vrai que la VR a ce côté fascinant : même quand l’image est identique à celle du casque, les gens restent scotchés à la télé
Du coup, la dimension asymétrique rajoute carrément une mécanique de jeu : celui qui porte le casque est isolé du monde, non-voyant du monde réel. Par exemple il existe un jeu où il faut désamorcer une bombe et celui qui porte le casque ne voit rien : il est assisté par ceux qui le guide en regardant les images de la télé. Un choix technologique peut ainsi amener une nouvelle façon de jouer.
Vous l’avez dit, votre équipe a gagné un surnom : Team Asobi, ce qui est très rare. Pour donner un équivalent d’une autre équipe hébergée par Japan Studio il y a la Team Ico (responsable d’Ico, Shadow of the colossus et The Last Guardian). C’est très prestigieux. Comment un “petit” Français se retrouve dans cette configuration au Japon ?
Trouver un nom n’était pas forcément tourné vers l’extérieur, c’était aussi pour que les membres de l’équipe ne perdent jamais de vue notre objectif et nos valeurs. Il y a en quatre : la magie, l’innovation, la dimension ludique (“playful”) et la dimension inclusive. On veut donner le sourire aux gens. Et on aborde les thèmes de pop culture : par exemple dans PlayRoom VR il y a un peu de Godzilla, de Ghostbusters, de western, de Tom & Jerry, et tout ça n’est pas par hasard. C’est ce qui fait que le jeu devient universel.
La Team Asobi est autonome ?
Oui, très autonome. On s’est spécialisé dans un créneau qui fait qu’il n’est pas facile pour nos membres de changer d’équipe. Généralement dans une production classique, il y a peu de membres permanents dans une équipe : une dizaine sur cinquante par exemple, sur lesquels viennent se greffer des spécialistes. L’intérêt d’avoir un studio c’est d’avoir un pool de gens et de les affecter d’un projet à l’autre, avec un peu de repos au milieu pour qu’ils se reposent ou fassent de la recherche. Mais dans notre cas, l’équipe est petite et très spécialisée dont on en perd peu.
Combien de personnes pour faire Astro Bot: Rescue Mission ?
25. Et le noyau dur de la Team Asobi est de 15 personnes.
C’est bluffant, vraiment très peu pour faire un jeu aussi riche
C’est parce que chaque personne apporte vraiment quelque chose de spécial et que les gens ont souvent plus d’un rôle.
C’est vous qui recrutez ?
Oui, même en interne. Parfois certains profils sont très bons mais ne collent pas avec le reste de l’équipe. On est tous Japan Studio, mais c’est important qu’on ait notre identité à nous. Au sein de Japan Studio il y a toujours 5 à 6 productions simultanées, avec des grosses équipes qui travaillent et qui sont dissoutes avec seulement 10% qui restent à la fin. Nous on garde les effectifs mais on ne grossit pas énormément.

La signature informelle de vos jeux passe par un personnage de petit robot : on le retrouve dans Playroom comme évolution d’un personnage de EyePet, puis avec le robot de Robot Rescue du Playroom VR. C’est maintenant le héros d’Astro Bot: Rescue Mission.
Oui, ce personnage n’est pas un super héros. On va le garder. C’est très dur de réussir un personnage. Quand tout le monde vous dit qu’il est mignon et veut des figurines, on le garde car c’est dur de le réussir une deuxième fois.
L’équipe est internationale ? Vous travaillez en quelle langue ?
Très internationale. On travaille en japonais à l’oral et plutôt en anglais à l’écrit.
L’équipe de base est constituée de programmeurs et de game designers. Le côté visuel, artistique est arrivé plus tard, et on n’avait pas de gens disponibles dans le studio. Japan Studio préparait notamment The Last Guardian et Gravity Rush 2 : des jeux très artistiques. Donc les meilleurs artistes étaient pris. A ce moment-là un studio de Sony venait de fermer : Liverpool Studio, responsable notamment de Wipeout. Les membres clé ont monté leur studio et on a travaillé avec eux. Donc la partie artistique de Playroom puis Playroom VR était externalisée chez eux. On faisait des Skype quotidiens. A l’époque j’étais le seul membre étranger de l’équipe de Tokyo donc ils ont tous dû se mettre à l’anglais. Ils ont un bon niveau même s’ils le cachent très bien. J’ai ensuite fait venir un Allemand, qui est directeur artistique sur Astro Bot: Rescue Mission, puis un Anglais et un autre Français qui s’est occupé des boss du jeu. Aujourd’hui sur vingt-cinq personnes il y a six étrangers.
Pouvez-vous décrire le concept d’Astro Bot: Rescue Mission en quelques phrases ?
C’est un jeu de plateforme en réalité virtuelle, donc avec une vue d’ensemble du monde. Dans un jeu classique, la télé est une fenêtre sur le monde et il faut penser aux axes de caméra. En VR on devient la caméra : il suffit de bouger la tête pour voir ce qui se passe en haut, en bas, à droite ou à gauche. On peut donc choisir son angle de vue et on a un rapport avec la géométrie des niveaux qui devient naturel. On peut par exemple choisir s’il y a un petit mur de se décaler pour voir derrière. Dans ce genre qu’est le jeu de plateforme – qui est le plus vieux du monde – on a un rapport complètement différent qui se rapproche d’une expérience physique. On est un géant dans ce jeu et on contrôle un petit personnage : Astro que l’on doit amener à la fin de chaque niveau en sautant, rebondissant et tuant des ennemis au passage. Le but est aussi de retrouver les 200 personnages de l’équipage d’Astro qui ont été dispersés dans tout le jeu et sont parfois très bien cachés : c’est le côté chasse au trésor.
La première impression en jouant est l’infinie profondeur. C’est le premier jeu VR à utiliser vraiment tout l’espace visible. Parfois, il faut envoyer le personnage 20 mètres plus bas, et c’est vertigineux car il est tout petit. On voit à la fois le respect d’une tradition avec beaucoup de mécaniques de jeux de plateforme comme Mario, et la recherche de nombreuses d’innovations. Une idée géniale par exemple est que certains ennemis attaquent directement le joueur en aveuglant ou en brisant le casque. C’est la première fois qu’un jeu vidéo casse comme cela le quatrième mur, en faisant prendre conscience au joueur qu’il n’est pas le personnage qu’il incarne.
Exactement ! C’est très intéressant : dans un jeu vidéo classique comme Mario ou Crash Bandicoot, si on tombe et qu’on meurt on dit “ah ! je suis mort”. On s’est projeté dans le petit personnage. Dans Astro Bot ce n’est pas le cas : quand on meurt, c’est Astro qui est mort. C’est une relation : on existe dans ce monde et il y a deux personnages : le joueur à taille réelle, et Astro de taille minuscule. Développer le jeu avec ces deux niveaux de taille a été assez difficile : il y a un équilibre à avoir. 80% est pour Astro, les ennemis sont là pour lui. 20% sont à la taille du joueur, pour ne pas oublier qu’on est dans ce monde. Car adapter un jeu de plateforme à la taille de l’image du casque n’avait pas beaucoup de sens. Il y a aussi un travail de contact par les regards. Si on croise Astro quand il court, il s’arrête pour faire un petit coucou. Cette relation visuelle nous rappelle qu’on est là, et rajoute de la douceur : on s’inquiète pour lui. J’ai écouté des joueurs vraiment désolés pour lui après l’avoir tué, s’excuser. On n’a jamais ce genre de réaction dans un Mario ou dans un God of War. On a crée de l’empathie, de la compassion, alors qu’on n’avait pas vraiment imaginé au départ amener des émotions nouvelles.

Ceci est le porte-carte de Nicolas Doucet.
Avec quelles autres innovations avez-vous construit votre gameplay ?
Deux autres aspects sont importants. D’abord la stéréoscopie. On a un écran en face de chaque oeil, donc on juge les distances beaucoup mieux quand dans un jeu classique. Avec la stéréoscopie on voit vraiment bien, pour faire un saut précis même en diagonale. C’est très important en termes de satisfaction de jeu. Ensuite, il y a un côté plus émotionnel : avec la réalité virtuelle on peut se rapprocher tout près du personnage et regarder ses détails.
La manette évolue aussi et se transforme en gadgets : grappin, shuriken, tuyau d’eau… ce qui renouvelle sans cesse le gameplay
Oui, la manette sur PlayStation est traquée. Quand on a le casque VR on ne voit pas ses mains mais on voit la manette, c’est un point de repère qui empêche d’être coupé du monde. En plus de ça, on utilise son touchpad pour transformer la manette qui devient un gadget utile à Astro, par exemple un grappin pour tendre une corde au-dessus d’un précipice. La manette renforce ainsi cette présence physique dans le monde, qu’on n’utilise pas dans tous les niveaux mais à certains moments particuliers.
Comment avez-vous réussi à échapper au motion sickness alors qu’on bouge tout le temps ? Y a-t-il beaucoup de R&D sur le sujet ?
Deux ingénieurs de l’équipe sont très calés sur le sujet, ils ont des masters en réalité virtuelle, ce qui aide beaucoup. On a essayé de faire simplement : tout bêtement le point de départ et le point d’arrivée sont parfaitement alignés horizontalement et verticalement. On a l’impression de passer partout en haut, en bas, etc. mais on suit une ligne toute droite et le niveau est construit autour. Sur le niveau avec les montagnes russes, le joueur va tout droit et c’est la piste qui bouge. Il y a aussi la distance avec Astro : quand il avance, il nous tire. Une fois que le joueur dans sa tête a établi cette distance, son cerveau est en contrôle et s’habitue à cette distance, ce qui aide à passer outre le motion sickness. Le casque par ailleurs ne fait jamais de rotation : c’est le joueur qui décide de regarder en haut ou en bas. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Si Astro recule, on ne bouge plus. On pouvait le faire dans la démo de Playroom VR, mais ça rendait malade alors on l’a enlevé. C’est une des critiques qu’on a eues sur le jeu, mais ça a été fait pour le confort.
Il y a une grosse ambition visuelle aussi. Comment vous êtes-vous approprié le projet en tant que directeur créatif ?
Il y a un directeur artistique à qui l’on doit cette réussite. Les casques de VR ont une dalle qui se comporte différemment des écrans de télévision. On a dû oublier ce que font les jeux vidéo traditionnels pour se focaliser sur ce qui fonctionne sur l’écran des casques en termes de matériaux, de textures… C’est un jeu simple mais bien fini au niveau des textures. Il n’y a pas beaucoup de détails à la différence des jeux vidéo traditionnels qui rajoutent beaucoup de bruit ou de saleté par exemple dans le bois pour le rendre réaliste, mais ça ne fonctionne pas comme ça en réalité virtuelle. On fait un jeu fantaisiste donc on a pu se dégager de tout ce qui est réaliste. On évite l’effet “Uncanny Valley” qui veut que si on se rapproche beaucoup du réalisme sans l’atteindre, c’est vraiment très bizarre. Notre directeur artistique est particulièrement fort pour le product design : le métal ou le verre sont très réussis quand on regarde Astro de près par exemple. C’est un réalisme mais stylé.
Le design global du jeu très kawai semble très tourné vers le marché japonais. Est-ce le cas ?
Non, pas trop. On cherchait quelque chose d’universel et plutôt dans le style Pixar. Je pense qu’on ressent l’inspiration de Wall-E. D’ailleurs, ce sont plutôt des anglais qui ont travaillé sur le design du robot.

Quelles sont vos influences en matière de game design.
J’admire le travail de Nintendo, ainsi que celui sur la série Crash Bandicoot. J’aime aussi beaucoup de jeux « die and retry » contemporains, où l’on revient très vite au niveau après être mort, sans attendre. En termes de character design, mon influence ultime est Mega Man : le personnage a les poses ultimes.
C’est quoi les règles d’un bon jeu en VR ?
Il faut que le concept du jeu soit impossible à faire sans la VR, et que la VR permette des émotions nouvelles. Il y a eu le moment Mario 64, on a compris tout de suite la potentialité qu’offrait la 3D. Moi quand j’ai mis un casque VR, c’était une expérience bidon : on se retrouve au sommet d’un plongeoir aux JO de Pékin, et… c’est tout ! Mais pour moi ça a été un nouveau moment Mario 64, quelque chose qu’on ressent tous les vingt ans et qui ne s’explique pas : une dimension s’est cassée et c’est très dur de revenir en arrière.
Comment voyez vous l’avenir de la réalité virtuelle ?
Pour moi ce n’est pas le futur du jeu vidéo mais une nouvelle façon de jouer, comme le jeu sur mobile qui a été dénigré au début. Il y a encore beaucoup de chemin pour le confort, ou sur le côté inclusif qui est ce que j’aimerais voir s’améliorer. Des expériences plus faciles à mettre, à montrer, à expliquer. On ne peut pas comprendre la réalité virtuelle sans essayer. C’est un challenge intéressant et important qui devient une urgence.
Envie de découvrir Terra Incognita ?
Terra Incognita veut réinventer la relation entre un média & ses lecteurs, c’est pourquoi nous emmenons des lecteurs sur chacune de nos interviews. Nous développons notre média avec deux valeurs : la transparence, le travail journalistique se fait sous les yeux des lecteurs & l’action, le média étant là pour aider chacun (citoyens, entrepreneurs, grands groupes, …) à s’engager face aux grands challenges de notre temps.